Newsletter août 2022
Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
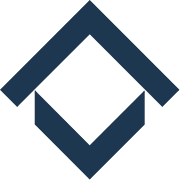
Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S.
Cette nouvelle newsletter paraîtra mensuellement et est créée sous l’égide de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, de son hubimmobilier (hub-immobilier.ch) et en collaboration avec la Chambre des avocats spécialistes FSA du droit de la construction et de l’immobilier. Elle est placée sous la responsabilité du professeur François Bohnet, ainsi que de Marcel Eggler, avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier et Simon Varin, avocat et collaborateur scientifique à l’Université de Neuchâtel.
Sur le site immodroit.ch, vous trouverez la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que des analyses de texte qui vous permettront de mieux comprendre les évolutions dans ces domaines.
Vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici.
Contrat de courtage; salaire du courtier; art. 412 et 413 CO
Salaire du courtier (rappel des principes) – On distingue, selon l’art. 412 al. 1 CO, le courtage par lequel le courtier est chargé d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention (courtage d’indication) du courtage par lequel le courtier est chargé de négocier la conclusion d’un contrat (courtage de négociation) contre une rémunération. Le contrat de courtage est en général soumis aux dispositions relatives au mandat simple (art. 412 al. 2 CO).
Si le courtier est tenu contractuellement de servir d’intermédiaire pour la conclusion du contrat, l’étendue de ses obligations est déterminée par la convention contractuelle ou la nature de la transaction. Sauf convention contraire, le droit au salaire du courtier suppose un lien de causalité entre l’activité du courtier et la conclusion effective du contrat principal ou de la transaction cible, un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers étant suffisant. Le lien psychologique peut exister même si les négociations ont été rompues entre-temps, également dans l’hypothèse où le courtier n’a pas été impliqué jusqu’à la conclusion du contrat ou encore si un autre courtier est intervenu. Il n’y a pas de lien psychologique suffisant uniquement lorsque l’activité du courtier n’a pas abouti à un résultat, que les négociations ont été définitivement rompues et que la vente a finalement été conclue sur une toute nouvelle base.
Intervention du courtier – Il incombe au courtier de prouver que son intervention – à savoir son entremise en cas de courtage de négociation ou ses indications en cas de courtage d’indication – a conduit au succès défini contractuellement. Selon l’art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. En raison de la nature dispositive de l’art. 413 al. 1 CO, cela n’exclut pas que le remboursement des frais (art. 413 al. 3 CO), le paiement d’honoraires ou d’une commission puissent être prévus par le contrat de courtage et ce, même dans l’hypothèse où le contrat entre le tiers et le client n’est pas conclu (consid. 3.1.1).
En l’espèce, la demande de reddition de compte est rejetée, les recourants n’ayant ni exposé concrètement quels documents originaux ils n’auraient pas récupérés, ni établi un lien entre la prétendue violation du devoir de diligence de l’intimée et la demande de restitution des honoraires invoquée en conséquence. La demande en remboursement des honoraires est également rejetée, dans la mesure où le courtier s’est seulement engagé à trouver un acheteur pour un prix minimum, tâche qu’il a accomplie avec succès. Dans ce cas, peu importe de savoir si l’intimée a rempli le contrat de courtage et a mérité les honoraires ou de savoir avec qui d’autre, en dehors de l’acheteuse ultérieure de l’immeuble, le courtier a négocié, dans la mesure où il est certain et incontesté que l’immeuble a été vendu grâce aux efforts de celui-ci (consid. 3.3).


Contrat de vente d'immeuble; dol; garantie en raison des défauts; art. 18 et 197 ss CO
Garantie pour les défauts (rappel des principes) – Aux termes de l’art. 197 CO le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Constitue un défaut, l’absence d’une qualité promise par le vendeur ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. Cette qualité promise doit encore être décisive pour l’acheteur. Toutefois lorsque d’après le cours normal des choses, l’assurance est de nature à emporter la décision de l’acheteur, la causalité est présumée. Afin de déterminer si une indication de qualité par le vendeur devait être considérée comme une promesse, il convient de procéder à l’interprétation du contrat (consid. 5.1).
Interprétation du contrat (rappel des principes) – Art. 18 CO (consid. 5.1.1 à 5.1.3). En l’espèce, faute de pouvoir déterminer la volonté réelle des parties, il apparaît que l’indication d’une surface de 110 m² par la venderesse devait être considérée comme une qualité promise d’après les règles de la bonne foi (consid. 5.2 et 5.3).
Dol et clause limitative de responsabilité, avis des défauts – Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts. Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur, les défauts de la chose (art. 199 CO). S’il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l’acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l’art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement, sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 2 et 3 CO). La loi institue une fiction d’acceptation qui entraîne la péremption de tous les droits de garantie. Toutefois, lorsque le vendeur a induit l’acheteur en erreur intentionnellement, il ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Sont visées non seulement les situations où le vendeur a dissuadé l’acheteur de vérifier la chose vendue et de donner l’avis des défauts, mais aussi les hypothèses de tromperies sur les défauts ou les qualités attendues ; la fiction d’acceptation de l’ouvrage est alors inapplicable (consid. 6.1).
En l’espèce, la venderesse savait que son appartement avait en réalité une surface de 92 m², dès lors qu’elle déclarait régulièrement cette surface dans sa déclaration d’impôts. Par conséquent, la clause limitative de responsabilité est nulle et la venderesse ne peut se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts (consid. 6.2).
Rapport entre les vices du consentement et la garantie pour les défauts – Lorsque l’exécution du contrat de vente est défectueuse, l’acheteur a le choix entre l’invalidation du contrat pour vices du consentement et l’action en garantie des défauts. Lorsqu’il opte pour l’action en garantie des défauts, l’acheteur ratifie implicitement le contrat ; partant, l’action en garantie implique un contrat existant. En l’espèce, en faisant valoir ses droits attachés à la garantie pour les défauts et la différence de surface de l’appartement vendu, l’acquéresse a ratifié implicitement le contrat entaché d’une erreur et fait valoir ses droits attachés à l’exécution imparfaite du contrat, spécifiques au contrat de vente, conformément à la jurisprudence fédérale (consid. 7.1 et 7.2).


Contrat de vente immobilière; représentation; art. 32 et 33 CO
Conditions de validité de la représentation. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l’absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l’absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (consid. 4.1).
En l’espèce, l’on ne peut pas retenir l’existence d’une ratification pour des travaux d’assainissement liés à une pollution du terrain constatée après la vente, lorsque l’interlocuteur – au bénéfice d’une procuration limitée dans le temps et expressément limitée à la représentation de la venderesse pour la conclusion de l’acte de vente – a uniquement apposé son visa sur un courrier de la partie acquéresse, après que la procuration a expiré (consid. 6.4).


Contrat de vente immobilière; erreur de base; art. 24 al. 1 ch. 4 et 26 CO
Erreur de base (rappel des principes) – Un contrat n’engage pas celui qui, lors de sa conclusion, s’est trouvé dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Une telle erreur existe notamment lorsque l’erreur portait sur un état de fait déterminé que la personne qui s’est trompée considérait, selon les règles de la bonne foi dans les relations commerciales, comme un fondement nécessaire du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Outre le caractère subjectif essentiel, il est nécessaire que l’état de fait sur lequel se fonde l’erreur apparaisse aussi objectivement, conformément au principe de la bonne foi dans les relations commerciales, comme le fondement nécessaire du contrat. L’erreur selon l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, mais uniquement si ce fait pouvait être considéré objectivement comme certain au moment de la conclusion du contrat. Il faut en outre que la partie adverse ait dû reconnaître que la certitude de la survenance de l’événement futur était une condition contractuelle pour l’autre partie. Est objectivement essentielle une idée fausse qui est nécessairement commune aux deux parties, consciemment ou inconsciemment, et qui, considérée objectivement, a été une condition indispensable à la conclusion du contrat (consid. 2.1).
Invocation de l’erreur de base en cas de négligence de la personne dans l’erreur – Il peut y avoir une erreur de base au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO même si l’erreur est due à la négligence de la personne qui s’est trompée. La négligence ne prive donc en principe pas l’auteur de l’erreur de l’invoquer, mais elle a en général pour conséquence qu’il doit verser des dommages-intérêts à sa partie adverse conformément à l’art. 26 CO. Le principe de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO) constitue toutefois une limite à l’invocation de l’erreur de base. Si, lors de la conclusion du contrat, une partie ne se préoccupe pas de clarifier une question évidente, l’autre partie peut en déduire, selon les règles de la bonne foi, que cette circonstance n’est pas considérée par le partenaire comme un fondement nécessaire du contrat. Un comportement négligent peut donc, justement en relation avec d’autres circonstances, faire apparaître une invocation de l’erreur sur les fondements comme contraire à la loyauté et donc irrecevable (consid. 2.1).
En l’espèce, s’informer trois années avant la vente immobilière d’un possible changement d’affectation du terrain vendu n’est pas suffisant ; une partie contractante consciencieuse aurait dû, avant de signer le contrat, se renseigner auprès de la commune sur les possibilités de changement d’affectation actuelles et pertinentes pour la vente, afin d’éviter toute erreur. Dans ces circonstances, l’acheteur doit se laisser imputer l’absence de clarification comme une négligence et son erreur, selon laquelle le changement d’affectation d’une grange était exclu, doit être imputée à son manque de diligence. Il s’agit donc d’une erreur par négligence au sens de l’article 26 CO (consid. 2.5 et 2.6).

Contrat de vente immobilière; clause d'exclusion de garanties; art. 199 et 200 CO
Responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est moins stricte pour les qualités attendues que pour les qualités promises, puisque, dans le premier cas, le vice doit entraîner (au moins) une diminution notable de l’utilité prévue ou de la valeur (objective) de la chose. Le niveau d’exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret. De manière générale, la perte de valeur ou d’utilité est notable lorsque l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions différentes s’il avait connu le vice (consid. 4.1).
Dissimulation frauduleuse. La « dissimulation frauduleuse » au sens de l’art. 199 CO couvre des comportements de dol et de tromperie intentionnelle. Elle est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d’aviser son cocontractant d’un défaut alors qu’il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi. Savoir s’il existe un devoir d’informer dépend des circonstances du cas concret. Le vendeur est tenu de détromper l’acheteur lorsqu’il sait – ou devrait savoir – que celui-ci est dans l’erreur sur les qualités de l’objet ou lorsqu’il s’agit d’un défaut (notamment caché) auquel l’acheteur ne peut de bonne foi pas s’attendre, et qui revêt de l’importance pour celui-ci. Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut. L’ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l’origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l’oblige à en informer l’acheteur. Le vendeur est dispensé d’informer l’acheteur lorsqu’il peut de bonne foi partir du principe que l’acheteur va s’informer lui-même, qu’il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés. La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit (consid. 4.2).
Nulle violation de l’art. 199 CO ne se conçoit donc sur le fondement de garanties qui n’ont pas été données à l’acheteur (consid. 6.2).


Contrat d'entreprise; intégration de la norme SIA 118 en tant que Conditions générales du contrat; art. 93 CPC; SIA 118
Intégration de la norme SIA 118 dans le contrat d’entreprise – rappel des principes. La validité des conditions générales préformulées, dont fait partie la norme SIA 118, est limitée par la règle de l’insolite. Selon cette dernière, sont exclues d’une acceptation globale des conditions générales du contrat toutes les clauses inhabituelles dont l’existence n’a pas été signalée séparément à la partie qui donne son accord. Le caractère inhabituel s’apprécie du point de vue de celui qui donne son consentement au moment de la conclusion du contrat. Il faut notamment tenir compte du fait que la personne qui donne son consentement est ou non au fait des affaires et de la branche : moins elle a d’expérience des affaires ou de la branche, plus une clause aura de chances d’être inhabituelle pour elle. Ainsi, des clauses usuelles dans la branche peuvent être inhabituelles pour une personne étrangère à la branche, mais pas pour une personne connaissant la branche. La connaissance de la branche ou l’expérience commerciale n’exclut toutefois pas nécessairement le caractère inhabituel. Même pour une personne connaissant la branche ou ayant de l’expérience dans les affaires, une clause des conditions générales peut, dans certaines circonstances, être inhabituelle. La règle de l’insolite est un instrument de la doctrine du consensus ; elle concrétise le principe de la confiance, qui vise à protéger la bonne foi dans les relations commerciales et ne vise pas en premier lieu à protéger la partie la plus faible ou inexpérimentée contre la partie la plus forte ou expérimentée (consid. 3.1.1).
Fardeau de la preuve de l’intégration. La simple invocation d’un fait négatif, en l’occurrence l’absence d’expérience invoquée par le maître, n’oblige pas l’entrepreneur à prouver l’expérience de son cocontractant, à défaut de quoi le fardeau de la preuve serait renversé. L’entrepreneur peut ainsi se limiter à contester l’inexpérience de son cocontractant (fardeau de la contestation), ce qui impose une obligation à ce dernier de prouver le fait dont il déduit un droit, à savoir l’application de la règle de l’insolite en sa faveur (consid. 3.1.5.2).
Compensation et prétentions reconventionnelles. Le maître de l’ouvrage invoque la compensation avec la prétention en paiement en raison des défauts liés à l’exécution défectueuse. L’entrepreneur invoque la réception de la chose selon la norme SIA 118 et la reconnaissance du décompte final sans avis de défaut pour contester la prétention en dommages-intérêts lié aux défauts reconnus par expertise judiciaire. Le Tribunal ne peut pas limiter son examen aux prétentions du demandeur mais doit examiner l’entier des prétentions reconventionnelles invoquées en compensation (consid. 3.2).
Valeur litigieuse. Il n’est pas critiquable que les instances cantonales additionnent les valeurs litigieuses des prétentions invoquées en paiement de l’ouvrage et en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le calcul de la valeur litigieuse, dans la mesure où les questions juridiques peuvent différer, notamment sur le respect du délai de 4 mois (consid. 5.3).



Contrat d'entreprise; exception d'inexécution; art. 82 CO et 153 SIA 118
Exception d’inexécution (rappel des principes) – Celui qui, dans un contrat bilatéral, veut obliger l’autre à s’exécuter doit, selon l’art. 82 CO, soit avoir déjà exécuté, soit offrir d’exécuter, à moins que, d’après le contenu ou la nature du contrat, il ne doive s’exécuter que plus tard. L’art. 82 CO accorde au débiteur une exception suspensive ayant pour effet qu’il peut retenir la prestation exigée jusqu’à ce que la contre-prestation ait été fournie ou offerte. Le créancier peut se contenter d’agir en justice pour obtenir une prestation sans réserve. Il incombe au débiteur de soulever l’exception. Si l’exception est justifiée, c’est-à-dire si le créancier n’a ni fourni ni offert la prestation, le tribunal protège l’action en ce sens qu’il condamne le débiteur à la prestation « trait pour trait », c’est-à-dire à une obligation sous condition suspensive. Il incombe au débiteur de soulever l’exception ; l’autorité ne saurait le faire d’office.
Si le débiteur soulève l’exception, c’est au créancier de prouver qu’il a fourni sa propre prestation ou qu’il l’a dûment offerte, de sorte que l’art. 82 CO déroge au principe selon lequel le fardeau de l’allégation (objectif) incombe à la personne chargée de la preuve. En revanche, l’art. 82 CO n’entraîne pas de renversement du fardeau de la preuve. La règle générale de l’art. 8 CC s’applique : il incombe d’abord au créancier qui veut faire valoir sa créance d’alléguer et de prouver les faits qui permettent d’établir l’existence de sa créance. Le débiteur qui soulève l’exception d’inexécution du contrat doit prouver l’existence de sa contre-créance. Il incombe ensuite au créancier de prouver l’exécution ou la bonne offre de sa propre prestation, ce qui signifie également qu’il supporte les conséquences de l’absence de preuve (consid. 3.1.1).
Interprétation d’un contrat (rappel des principes) – (consid. 3.1.2) ; droit à la preuve (rappel des principes (consid. 3.1.3) ; administration anticipée des preuves (consid. 3.1.4). En l’espèce, l’exception d’inexécution a été soulevée à bon escient. En effet, le droit au solde du prix de l’ouvrage, qui est exigible, et le droit à la réparation, qui est également exigible, s’opposent. L’entrepreneur ayant refusé jusqu’à présent de procéder à la réparation, le maître d’ouvrage doit être condamné à verser le solde du prix de l’ouvrage en échange du remplacement de la tuyauterie litigieuse (consid. 3.3.4 et 3.4). En outre, un décompte final au sens de l’art. 153 de la norme SIA 118 ne constitue pas un contrat de compte courant, qui pourrait être résilié et qui comprendrait toutes les créances ouvertes résultant du contrat d’entreprise et qui pourrait faire échec à l’exception d’inexécution (consid. 3.4.1).


Contrat d'entreprise; intégration de la norme SIA 118 et maxime des débats; art. 55 CPC; 102-107 CO; 55, 153-155 et 190 SIA 118
Intégration de la norme SIA 118 – La norme SIA 118 est le recueil de règles de la Société privée des ingénieurs et des architectes suisses. Selon la pratique du Tribunal fédéral, les règlements d’organisations privées n’ont pas la qualité de normes juridiques, même lorsqu’ils sont très détaillés et exhaustifs, comme par exemple la norme SIA 118. Le Tribunal fédéral ne reconnaît pas la norme SIA 118 comme un usage imposant des règles (regelbildende Übung) et ne s’y réfère que si les parties l’ont élevée au rang de contenu contractuel. Si une partie se réfère à la norme SIA 118, elle doit affirmer et prouver qu’elle est devenue partie intégrante du contrat. Il n’est pas arbitraire de reconnaître que le contenu de la norme SIA 118 est un fait notoire (consid. 5.2).
Si une partie se réfère à la norme SIA 118, elle doit affirmer et prouver qu’elle est devenue partie intégrante du contrat. Il n’est pas arbitraire de reconnaître que le contenu de la norme SIA 118 est un fait notoire (consid. 5.2).
Maxime des débats en cas d’intégration de la norme SIA 118 – Si la norme SIA 118 est intégrée dans le contrat, le tribunal est libre d’apprécier d’office, dans le cadre de l’application du droit, l’ensemble du contrat, y compris la norme SIA 118 reprise globalement. De même, le tribunal peut, sans violer la maxime de disposition, tirer des conclusions sur les obligations contractuelles à partir des différentes dispositions du contrat, même si les parties ne fondaient pas leur prétention en détail sur les clauses contractuelles pertinentes (consid. 5.3.2).
En l’espèce, l’instance précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir les délais de paiement contenus explicitement dans le contrat d’entreprise pour le calcul des intérêts moratoires et écarter le délai de l’art. 154 de la norme SIA 118 (consid. 5.3.3). L’instance précédente a toutefois commis une faute de calcul, de sorte que le recours est partiellement admis (consid. 5.3.4).



Contrat d'entreprise; prix forfaitaire; art. 373 CO
Prix ferme ou prix forfaitaire (art. 373 CO) – Le forfait vaut pour autant que l’ouvrage finalement exigé par le maître corresponde à celui projeté lors de la conclusion du contrat, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Des modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l’entrepreneur (consid. 4.1). Si l’entrepreneur prétend à une rémunération supplémentaire, il doit prouver avoir fourni une prestation non incluse dans les travaux faisant l’objet du contrat d’entreprise, et partant non couverte par le prix forfaitaire fixé pour ceux-ci. Ceci dit, c’est l’interprétation du contrat qui permet de déterminer quelles prestations avaient été initialement convenues. Comme le souligne finement la doctrine, certaines imprécisions peuvent profiter à l’entrepreneur, dans la mesure où le descriptif des travaux émane du maître (consid. 4.2).
En l’espèce, le recourant maître de l’ouvrage a attendu la procédure judiciaire pour objecter qu’il n’avait jamais approuvé les travaux supplémentaires, les reproches antérieurs étant jugés trop vagues ou concernaient d’autres points litigieux. Ainsi le recourant n’avait certes pas approuvé au préalable et par écrit les travaux supplémentaires, en particulier la rémunération y afférente, mais il a finalement accepté ces travaux exécutés avec l’assentiment de son architecte. Partant, il doit en assumer le surcoût (consid. 5.3).


Contrat d'entreprise; prix de l'ouvrage; art. 374 CO
Caractère dispositif de l’art. 374 CO – Faute d’accord préalable sur le prix de l’ouvrage, il n’y a pas matière à s’écarter de la règle générale et subsidiaire de l’art. 374 CO, selon laquelle le prix doit dans ce cas être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (consid. 2.2).
Obiter dictum – En l’espèce, le prix de l’ouvrage censé être fixé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO) a en réalité été établi selon les tarifs en régie d’une association professionnelle. Ce procédé était admissible dans la mesure où il s’agissait d’une pratique usuelle aux dires de l’expert. D’aucuns soulignent qu’on ne saurait se contenter de la preuve d’un tel usage lorsque la disposition légale topique – ici l’art. 374 CO – ne s’y réfère pas : une intégration expresse ou tacite par les parties devrait être établie, le cas échéant indirectement, par renvoi à l’usage incluant lesdits tarifs. Le grief n’ayant pas été soulevé, le recours est rejeté (consid. 2.3).


Responsabilité de l'employeur; relation entre droit civil et droit pénal; art. 53 et 55 CO
Interprétation de l’art. 53 CO – L’art. 53 CO n’est pas limpide mais il en ressort clairement qu’il ne concerne pas l’établissement des faits ni l’illicéité qui en résulte, de sorte qu’il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal. Le CPC étant muet sur le sujet, le juge civil n’est pas lié par l’état de fait arrêté par le juge pénal ; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l’illicéité. Ceci dit, rien n’empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d’investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu’il peut suivre l’avis du juge pénal, il rend là une décision d’opportunité (consid. 2.2).
Partant, dans le cas d’espèce, l’instance précédente n’a pas violé l’art. 53 CO en s’écartant de l’analyse des juges pénaux et en reprochant à l’auxiliaire, dans une configuration des lieux particulièrement dangereuse, d’avoir omis de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter à l’un des autres intervenants de marcher sur le trou qu’il venait d’occulter par une fine couche d’isolation (consid. 2.3).
Responsabilité de l’employeur – L’art. 55 CO institue une responsabilité spécifique pour le fait d’autrui, fondée sur un manque de diligence de l’employeur qui est présumé. L’employeur qui tire profit des services de son auxiliaire doit aussi supporter les conséquences de ses manquements (respondeat superior), d’autant que l’intéressé n’a souvent guère les moyens économiques de réparer le dommage causé dans l’exécution de son travail. Pour s’exculper, l’employeur doit prouver qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes (cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu’un comportement diligent n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l’employeur sont élevées ; l’admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l’auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l’impossible : il faut s’en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d’une entreprise (consid. 3.2).
En l’occurrence, les juges vaudois n’ont pas enfreint le droit fédéral en considérant que la configuration très dangereuse créée par le recouvrement du trou et l’absence de barrière imposait des mesures telles que celles prescrites (consistant en particulier à demander l’aide d’un des ouvriers présents), même pour un bref instant, sachant que deux autres personnes travaillaient sur ce même étage (consid. 3.3.2).
La responsabilité de l’employeur va au-delà de la responsabilité pour faute classique et il ne peut se prévaloir de sa situation personnelle : il doit prouver avoir pris toutes les mesures dictées par des critères objectifs et les circonstances concrètes. La pratique se montre restrictive dans l’admission des moyens libératoires, ce qui peut notamment être relié à la ratio legis de l’art. 55 CO et aux considérations économiques qui sous-tendent cette règle (consid. 3.5.2).

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; inscription définitive; art. 839 CC; 63 CPC
Litispendance rétroactive en matière d’hypothèque légale – Le recourant a déposé une requête de conciliation, en demandant l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ; l’autorité de conciliation n’est pas entrée en matière sur la requête, faute de compétence matérielle. Le recourant dépose ensuite une demande d’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs auprès du tribunal régional. Le tribunal n’est pas entré en matière sur la demande au motif que ce n’est pas la demande initiale qui a été déposée, mais une demande qui s’en distingue nettement.
La litispendance rétroactive au sens de l’art. 63 al. 1 CPC pour une requête déposée préalablement auprès d’une autorité de conciliation incompétente devant le tribunal compétent est en soi possible, mais suppose que le même acte juridique soit déposé en original, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 2-3).
Le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence dans cette constellation (ATF 145 III 428) : le justiciable qui s’est adressé par erreur à l’autorité de conciliation au lieu de saisir directement le tribunal doit déposer la requête initiale, qui avait été déposée auprès de la mauvaise instance, à nouveau en original dans le délai imparti auprès du tribunal compétent. Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence en cela que la partie concernée peut, le cas échéant, s’exprimer une seconde fois – dans le cadre d’un second échange d’écritures ou oralement lors d’une audience d’instruction ou au début des débats principaux, préalablement aux premières conclusions des parties – sans restriction et ainsi remédier en grande partie aux conséquences négatives de son oubli (consid. 4).


Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; principes de disposition; répartition du montant du gage entre les unités d'étages; art. 56 et 58 CPC; 839 CC
L’art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il s’agit là de la conséquence principale de la maxime de disposition, qui est l’expression en procédure du principe de l’autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (consid. 3.1)
Le juge saisi d’une demande tendant à l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble de base alors que les parts d’étages sont déjà grevées n’est, conformément à la maxime de disposition, pas autorisé à répartir d’office le droit de gage sur les parts d’étages mais doit débouter l’entrepreneur de ses conclusions (consid. 3.4).


Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; maxime des débats et caractère réformatoire de l'appel; art. 55 et 318 CPC
Maxime des débats, fardeaux de l’allégation et de la contestation (rappel des principes) – (consid. 2 et 3.3) ; renvoi à une pièce (consid. 2.2.3).
En matière d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, lorsque la partie demanderesse a établi des rapports journaliers, comportant des inscriptions manuscrites aisément lisibles et précisant quand et pour quelle maison ou pour quel terrain quels travaux ont été entrepris, il incombe à la défenderesse de contester avec précision les travaux, ce qu’elle n’a pas fait dans le cas d’espèce (consid. 2.3.2 et 3.4). Il en est de même s’agissant de l’allégation du délai de quatre mois pour obtenir l’inscription de l’hypothèque ; dans la décision, un renvoi aux pièces est également possible, lorsqu’elle motive séparément que le délai est respecté pour chaque immeuble (consid. 2.4-2.4.3).
Pour prouver l’existence des différents travaux litigieux, plusieurs centaines de pages de pièces justificatives étaient nécessaires avec notamment tous les métrés individuels. Intégrer ces éléments dans l’acte aurait massivement augmenté son volume, sans pour autant fournir davantage d’informations au tribunal ou à la partie adverse et aurait donc équivalu à un véritable travail à vide. En l’occurrence l’acte comprend néanmoins les faits qui sont allégués, du moins dans leurs grandes lignes, de sorte que l’on se trouve précisément dans le cas où une multitude d’informations individuelles sont nécessaires, que le transfert des informations dans une annexe ne constitue pas un alourdissement, mais peut au contraire faciliter aussi bien la lisibilité du mémoire juridique que l’accès aux informations correspondantes (consid. 2.4.4.2).
Caractère réformatoire de l’appel – L’instance d’appel décide selon son appréciation si elle rend une décision réformatrice ou cassatoire. Elle ne peut toutefois prendre une décision réformatrice que si elle est en état de statuer. La procédure est en état d’être jugée lorsque le tribunal dispose de tous les éléments pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. En outre, la procédure prescrite par la loi doit avoir été menée en bonne et due forme. Les bases factuelles nécessaires à l’appréciation de la prétention litigieuse doivent être disponibles et les parties doivent avoir eu la possibilité de s’exprimer sur toutes les questions pertinentes pour la décision. Aucune demande de preuve formulée conformément à la procédure ne doit rester ouverte sur des questions litigieuses pertinentes pour la décision. Aux yeux du législateur, un renvoi doit en principe être l’exception, sous peine de prolonger inutilement le procès (consid. 4.3.2.1).
Même lorsque le Tribunal de première instance a rejeté la demande pour un défaut de l’allégation, le Tribunal cantonal qui considère que l’allégation de la demanderesse est suffisante peut réformer la décision et rendre une décision au fond.


Contrat d'entreprise; demeure de l'entrepreneur et frais d'avocat avant procès; art. 102 et 107 CO
Demeure (rappel des principes) – Lorsqu’une obligation est exigible, le débiteur est mis en demeure par une sommation du créancier (art. 102 al. 1 CO). La mise en demeure est une déclaration du créancier adressée au débiteur, qui exprime qu’il exige la prestation sans retard. La mise en demeure doit désigner la prestation à fournir avec suffisamment de précision pour que le débiteur comprenne ce que le créancier veut exiger. La mise en demeure est une déclaration qui doit être reçue. Il convient de déterminer si les exigences de précision et de clarté sont remplies dans le cas d’espèce, sur la base des circonstances concrètes, par interprétation – en appliquant le principe de confiance (consid. 6.2.1).
En l’espèce, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en admettant que la demanderesse avait mis en demeure la reprise des travaux et non la livraison finale des machines (consid. 6.2.3).
Délai supplémentaire et pourparlers transactionnels – Tant que le créancier n’a pas fait son choix au sens de l’art. 107 CO, il peut fixer un nouveau délai supplémentaire au débiteur. La jurisprudence et la doctrine n’établissent pas de délai général dans lequel un nouveau délai supplémentaire devrait être fixé. Le créancier doit simplement respecter les principes de la bonne foi. En l’espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre le premier et le deuxième rappel. Dans l’intervalle, les parties ont continué à avoir des contacts, mais sans que le maître d’ouvrage ait expressément fait un choix au sens de l’article 107 CO. Il faut voir dans cette négociation une prolongation implicite du délai supplémentaire, même si celle-ci n’est pas assortie d’une date précise et ne peut donc pas entraîner d’effets de retard supplémentaires (consid. 6.3).
La location d’un local d’usine pour la machine à livrer peut constituer un poste du dommage (consid. 7).
Frais d’avocats avant procès (rappels des principes) – Les frais d’avocat avant procès peuvent faire partie intégrante du dommage, mais seulement s’ils étaient justifiés, nécessaires et raisonnables, s’ils servent à faire valoir la créance en dommages-intérêts et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’indemnité de la partie. La partie qui réclame le remboursement des frais d’avocat engagés avant le procès doit démontrer de manière circonstanciée, c’est-à-dire indiquer les circonstances qui plaident en faveur du fait que les dépenses invoquées doivent être considérées comme faisant partie intégrante du dommage et qu’elles étaient donc justifiées, nécessaires et raisonnables, qu’elles servent à faire valoir la créance en dommages-intérêts et qu’elles ne sont pas couvertes par l’indemnité de la partie (consid. 9.1). Les frais d’avocat avant le procès sont en règle générale indemnisés avec les dépens. Cela vaut notamment dans le domaine d’application du CPC. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils peuvent être poursuivis séparément en tant que dommage (consid. 9.2.2).
En l’espèce, l’instance précédente a attribué à la demanderesse des frais d’avocat qui ont été engagés à un moment où il fallait déjà s’attendre de manière réaliste à un éventuel procès, de sorte qu’elle s’est fondée sur une délimitation erronée du dommage en accordant à la demanderesse des frais d’avocat avant procès (consid. 9.2.2 et 9.3).


Contrat d'entreprise totale; maxime des débats; fardeau de l'allégation et de la contestation - renvoi à une facture; art. 55 CPC
Maxime des débats, fardeau de l’allégation (rappel des principes) – Maxime des débats (consid. 5.1). Dans un premier temps, une allégation de fait ne doit pas contenir tous les détails. Ce n’est que dans la mesure où la partie adverse conteste l’exposé concluant des faits de la partie à qui incombe la charge de l’allégation qu’intervient une charge de la preuve allant au-delà de la charge de l’allégation. Dans ce cas, les allégations doivent être présentées dans un deuxième temps, non seulement dans les grandes lignes, mais aussi de manière suffisamment détaillée et claire pour que la preuve puisse en être acceptée ou que la contre-preuve puisse être apportée (consid. 5.2).
Maxime des débats, fardeau de la contestation (rappel des principes) – Les contestations doivent être suffisamment concrètes pour permettre de déterminer quelles sont les affirmations individuelles du demandeur qu’elles contestent. La contestation doit être suffisamment concrète pour que la partie adverse sache quelle allégation de fait elle doit prouver. Le degré de matérialité d’une allégation influence donc le degré de matérialité requis pour une contestation : plus les différents faits d’un état de fait global sont allégués de manière détaillée, plus la partie adverse doit expliquer concrètement lesquels de ces différents faits elle conteste. Une contestation suffisante permet à la partie chargée de l’allégation de savoir lesquelles de ses allégations elle doit continuer à étayer et lesquelles elle doit finalement prouver (consid. 5.3). Si le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû et renvoie pour cela à bon escient à une facture annexée ou à un décompte détaillé, on peut exiger du défendeur qu’il désigne précisément les positions de la facture ou les points du décompte qu’il conteste. A défaut, la facture ou le décompte sont considérés comme insuffisamment contestés et donc acceptés (consid. 5.3).
Maxime des débats, renvoi à une annexe (rappel des principes) – La jurisprudence du Tribunal fédéral exige que la charge de l’allégation et de la preuve soit en principe remplie dans les mémoires. Le simple renvoi global aux annexes ne suffit généralement pas. Exceptionnellement, si des faits sont allégués dans leurs grandes lignes dans un mémoire et qu’il est renvoyé à une annexe pour les détails, il convient d’examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations nécessaires d’une manière telle qu’une reprise dans le mémoire apparaîtrait comme un simple exercice vide, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations nécessaires ne sont pas contenues de manière claire et complète dans les annexes ou qu’il faudrait les y chercher. Un accès aisé est garanti lorsqu’une pièce jointe est explicite et qu’elle contient exactement les informations demandées (consid. 5.4).
Allégation nécessaire selon le fondement juridique invoqué – Dans le cas d’une indemnisation d’après le travail fourni (art. 374 CO), le travail invoqué doit être exposé de manière à ce que sa nécessité et son adéquation puissent être vérifiées, ce qui suppose des indications compréhensibles sur les travaux effectués et les heures de travail consacrées à ceux-ci. Toutefois, lorsqu’il ne s’agit pas d’un salaire mais d’une prétention en dommages-intérêts fondée sur un contrat d’entreprise en raison d’une violation d’une obligation accessoire (devoir de diligence) concernant un bâtiment en construction, pour laquelle l’entrepreneur doit répondre selon les principes généraux de la responsabilité contractuelle (art. 364 al. 1 CO en relation avec les art. 97 ss CO), l’on ne saurait exiger une allégation quant à l’adéquation et à la nécessité des travaux effectués par les artisans. De telles exigences sont excessives quant au fardeau de l’allégation, respectivement ne portent pas sur le bon objet à alléguer (consid. 6.2.3), ces questions ne pouvant avoir une portée que s’agissant de l’obligation de réduire le dommage (consid. 6.2.4).
En l’espèce, le dommage était suffisamment allégué, puisque l’existence d’un dommage a été alléguée dans les grandes lignes dans le mémoire de demande, qu’il a été fait référence à deux pièces déterminées du dossier et qu’il ressort de ces pièces différentes positions, classées proprement et clairement par position CFC et mentionnées de manière claire et complète, les frais de remise en état étant au surplus mentionnés en détail, avec le total intermédiaire et le total général, de sorte que les différents postes du dommage ne doivent pas être recherchés ou interprétés d’une quelconque manière (consid. 7.3).
Face à cette situation, la défenderesse s’est contentée de contester le montant total du dommage et a déclaré que le dommage n’était aucunement étayé et démontré. Insuffisante, cette contestation conduit le Tribunal fédéral à considérer que le montant du dommage n’a pas été suffisamment contesté et qu’il doit être considéré comme admis (consid. 7.5 à 7.7).


Contrat d'architecte; expertise; récusation; art. 49 et 50 CPC
Compétence pour la nomination d’un expert. La décision portant sur la nomination d’un expert et qui se prononce sur des motifs de récusation articulés en amont de cette nomination constitue une ordonnance d’instruction dont la compétence peut être déléguée à un membre du tribunal (consid. 4.4).
Motif de prévention. L’appartenance commune à une institution publique ou privée, un club (Rotary, Lions Club, etc.), un institut, une association professionnelle, un parti politique ou une communauté religieuse ne fonde pas en soi une prévention, sans quoi planerait souvent le risque de ne trouver aucun expert. Cela étant, l’appartenance à une même communauté d’intérêts peut le cas échéant justifier une récusation lorsque le but idéal de l’entité a un rapport étroit avec l’objet du procès. L’expert n’est pas forcément prévenu parce qu’il se rallie à une certaine école de pensée ou à une méthode scientifique, quand bien même l’école ou la méthode est controversée et peut avoir une incidence sur le résultat de l’expertise. Encore faut-il que l’école ou la méthode soit reconnue scientifiquement et ne soit pas manifestement dépassée ou rejetée à une large échelle dans les milieux spécialisés. Les conceptions scientifiques de l’expert ne doivent pas protéger exclusivement le point de vue d’une des parties et donner à penser que le sort du procès n’est plus ouvert (consid. 5.2).
En l’espèce, la fonction de l’expert architecte au sein de l’Union internationale des architectes (UIA) dont il est vice-président ainsi que sa fonction de membre d’honneur de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) ne laissent apparaître aucune apparence de prévention ou de partialité (consid. 5.3).
Procédure de récusation. L’art. 49 al. 2 CPC impose d’interpeller « le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné » par la demande de récusation. La prise de position de la personne concernée sert à clarifier l’état de fait tout en lui permettant d’accepter ou de contester le motif de récusation. La jurisprudence concède des dérogations à cette règle tout au plus lorsque la requête est abusive ou manifestement infondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5.4).

