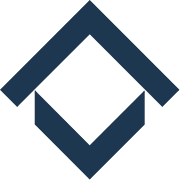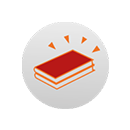Analyse de l’arrêt TF 4A_237/2025
30 septembre 2025
Concilier sans préjuger
I. Objet de l’arrêt
L’arrêt commenté traite la question de l’apparence de prévention d’un président d’un tribunal de commerce auquel il est reproché d’avoir présenté la solution juridique du cas d’espèce lors d’une audience d’instruction visant à concilier les parties.
Le Tribunal fédéral rappelle l’importance de la recherche d’une solution transactionnelle et examine les méthodes pour y parvenir. La Haute Cour nie toute apparence de prévention dans le cas d’espèce.
II. Résumé des arrêts
A. Les faits
A l’occasion d’une audience d’instruction faisant suite à un échange d’écritures, le président du tribunal de commerce du canton d’Argovie a fait part aux parties de son appréciation de l’affaire sur le plan factuel et juridique. Il leur a également soumis une proposition de transaction chiffrée. Au début de l’audience, il a attiré l’attention des parties sur le caractère provisoire de ses explications. Il a notamment estimé que les conditions de l’art. 366 al. 1 CO étaient remplies « mit Sicherheit » et qu’à cet égard, « es werde […] in jedem Fall etwas hängen bleiben ». Lorsque la défenderesse a contesté l’application de l’art. 366 al. 1 CO, le juge a répondu que, dans le cas contraire, l’art. 377 CO serait applicable. Les parties n’ont finalement pas pu s’entendre sur un règlement à l’amiable.
B. Le droit
Motifs de récusation, clause générale – Il existe un cas de récusation si l’une des circonstances énumérées à l’art. 47 al. 1 lit. a-f CPC est remplie. En l’espèce, il convient d’examiner si le juge pourrait être prévenu en application de la clause générale de l’art. 47 al. 1 let. f CPC. Lors de la concrétisation de cette clause générale, le Tribunal fédéral souligne qu’il convient de respecter les principes découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. [consid. 4.2.1]. Selon cette disposition ainsi qu’en vertu de l’art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a le droit d’être jugée par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Aucune circonstance étrangère à l’affaire et extérieure au procès ne doit influencer de manière inappropriée le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Cette garantie constitutionnelle doit contribuer à l’ouverture d’esprit nécessaire à un procès correct et équitable [consid. 4.2.2]. A cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que la garantie est déjà violée lorsqu’il existe, d’un point de vue objectif, des circonstances susceptibles de donner lieu à une apparence de partialité. Il ne faut pas se fonder sur le sentiment subjectif d’une partie ; le doute doit plutôt apparaître comme objectivement fondé [consid. 4.2.3].
Conciliation et apparence de partialité – Le Tribunal fédéral relève ensuite qu’à côté de la procédure contradictoire habituelle, aboutissant à une décision finale (fonction d’autorité judiciaire), les tribunaux s’efforcent d’amener le plus souvent possible les parties à conclure un accord. Pour le Tribunal fédéral, les tribunaux assument alors une autre fonction, un rôle de conciliateur, dont il convient de tenir compte lors d’une demande de récusation [consid. 6.2]. A l’appui de cette affirmation, le Tribunal fédéral souligne que l’art. 124 al. 3 CPC permet au juge de tenter une conciliation à tout moment. Dans le cas d’un tribunal collégial, c’est souvent un juge délégué qui mène les négociations en vue d’un accord [consid. 6.2.1]. Pour le Tribunal fédéral, la conciliation sert aussi bien à soulager les tribunaux que l’intérêt des parties. La solution trouvée est généralement plus durable et permet de tenir compte d’aspects extérieurs à la procédure [consid. 6.2.3].
Le Tribunal fédéral évoque également l’art. 205 CPC, selon lequel les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Il souligne que cette disposition est applicable par analogie aux négociations judiciaires. En effet, leur prise en compte serait incompatible avec le caractère provisoire et confidentiel de la procédure de conciliation. Par conséquent, après l’échec de la procédure de conciliation, une partie ne peut reprocher au tribunal d’avoir émis dans son jugement une appréciation juridique différente de celle qu’il avait donnée lors de la procédure de conciliation [consid. 6.2.4].
Pour le Tribunal fédéral, il convient aussi de tenir compte de la marge de manœuvre importante dont dispose le juge (ou le juge délégué) pour organiser la conciliation. En règle générale, le juge délégué procède à une évaluation des éléments du dossier. Il indique ensuite aux parties si, et dans quelle mesure, les prétentions invoquées sont fondées à son avis. Outre des indications sur d’éventuelles difficultés en matière de preuve, il fournit souvent des explications sur les conséquences en termes de frais judiciaires et dépens ainsi que sur la durée de la procédure en cas de décision. Les remarques sur des aspects extra-procéduraux ou post-procéduraux, tels que les difficultés d’exécution, sont également admissibles [consid. 6.2.5]. En fonction de l’évaluation des chances de succès du procès, le juge délégué peut proposer aux parties un retrait total ou partiel de la demande, ou une admission totale ou partielle de la demande ou une transaction. Une telle évaluation préliminaire de la situation factuelle et juridique, même défavorable à une partie, ne constitue pas en soi un soupçon de partialité [consid. 6.2.6].
Selon le Tribunal fédéral, plus le juge délégué argumente de manière précise pendant la procédure de conciliation, plus les parties seront enclines à accepter sa proposition. On attend toutefois de lui qu’il exprime avec réserve son appréciation des chances de succès du procès et qu’il réserve sa décision sur le fond. Cela vaut en particulier lorsqu’il existe une asymétrie entre les parties, par exemple parce qu’une seule partie est représentée par un avocat. La Haute Cour indique en conséquence, qu’il existe une tension entre la volonté du juge délégué de convaincre les parties de sa proposition et la réserve qui s’impose [consid. 6.2.7]. En effet, le juge instructeur qui a précédemment présidé la tentative de conciliation statue soit en tant que juge unique, soit en tant que juge rapporteur, en soumettant une proposition de décision au tribunal collégial. Afin de sensibiliser les parties à cet éventuel changement de rôle ultérieur, le juge délégué doit les informer du caractère provisoire de son évaluation. Pour ce faire, il n’a toutefois pas besoin de relativiser chacune de ses déclarations. Il suffit que les parties puissent reconnaître que le juge délégué apprécie le litige de manière provisoire et sur la base du dossier existant, qui est incomplet. Il doit également relever, le cas échéant, que les autres membres de la formation collégiale pourraient éventuellement parvenir à une conclusion différente. De même, si le juge délégué ne dispose pas des informations nécessaires et qu’il formule donc des hypothèses dans sa proposition ou s’il existe des incertitudes ou des risques, il doit en informer les parties [consid. 6.2.8].
Le Tribunal fédéral insiste sur le rôle actif du juge dans le cadre d’une conciliation judiciaire pour conduire les parties à un accord [consid. 6.2.9]. Ainsi, le rôle de conciliateur implique une interaction informelle importante entre le juge et les parties, laquelle doit être prise en compte lors de l’appréciation de la partialité. Des déclarations isolées, ambiguës ou maladroites du juge délégué ne doivent pas conduire à conclure sans autre à une partialité. Il convient plutôt d’examiner les déclarations ou le comportement du juge dans leur ensemble. Un cas de partialité peut par exemple être retenu lorsque le juge tient des propos désobligeants à l’égard d’une partie ou ignore systématiquement ses arguments et ses moyens de preuve [consid. 6.2.10]. Pour le Tribunal fédéral, l’évaluation par le juge des chances de succès dans une audience de conciliation ne permet à elle seule que de tirer des conclusions très limitées quant à l’existence d’un parti pris. Si le juge délégué s’est soigneusement préparé à l’audience de conciliation, il sera généralement plus convaincu de son évaluation que s’il s’est contenté de survoler au préalable le dossier. Ainsi, le degré élevé de conviction du juge délégué ne doit pas être considéré comme une preuve irréfutable de son manque d’ouverture à la décision en cas de poursuite litigieuse de la procédure. Les parties ont également un intérêt à connaître l’évaluation réelle des chances de succès par le juge. Le juge n’a ainsi pas besoin de dissimuler sa conviction derrière un voile de réserves, simplement par crainte d’être récusé [consid. 6.2.11]. Enfin, la procédure de récusation n’a donc pas pour but de corriger une erreur présumée ou effective dans l’application du droit, qui plus est dans le cadre d’une audience de conciliation, où le juge délégué ne procède pas à une évaluation définitive de la cause [consid. 6.2.12]. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral ne retient aucune apparence de prévention du juge dans le cas d’espèce [consid. 6.3].
III. Commentaire
a. La solution dans le cas d’espèce
Les mots reprochés au juge du tribunal de commerce pouvaient-ils justifier sa récusation ?
L’arrêt retient que le juge a attiré l’attention des parties sur le caractère provisoire de son évaluation de la cause en début d’audience. Ensuite, l’expression maladroite qui consiste à avoir indiqué que les conditions d’application du régime de l’art. 366 CO étaient réunies « mit Sicherheit » était relativisée par la formule plus globale, selon laquelle « es werde […] in jedem Fall etwas hängen bleiben ». Ce type de formule exprime probablement la position du conciliateur qui veut indiquer à une partie que, quelle que soit l’issue du procès, plus ou moins positive pour elle, elle ne pourra vraisemblablement pas gagner à 100%. Il s’agit d’un message généralement efficace, en particulier dans les litiges commerciaux, puisqu’une partie habituée aux affaires pourra facilement comparer, d’une part, le coût de la procédure si elle va à son terme et aboutit à un gain seulement partiel et, d’autre part, le coût de la transaction en cours de négociation, respectivement tel qu’il ressort de la proposition du juge.
Cette interprétation est renforcée par la remarque postérieure du juge selon laquelle, si l’art. 366 CO n’était pas applicable, il conviendrait alors de se tourner vers l’art. 377 CO. Cette affirmation semble démontrer que le juge n’avait pas fermement arrêté sa position sous l’angle de la disposition applicable, puisqu’il était en mesure d’envisager un régime tout à fait différent pour la trancher. Il passe en effet d’une résiliation du contrat imputable à l’entrepreneur en demeure et qui lui est largement défavorable (art. 366 CO) à une résiliation du contrat par le maître, sans faute de l’entrepreneur, laquelle doit être pleinement indemnisée (art. 377 CO ; intérêt positif donc y compris le bénéfice manqué). Le message global du juge consistait sans doute à indiquer aux parties qu’il était peu vraisemblable qu’elles sortent entièrement gagnantes de la procédure. On peut néanmoins s’interroger sur la portée d’une parole corrective, lorsque le juge a clairement donné, dans un premier temps, une apparence de prévention par ses affirmations. Selon les circonstances, il faudra certainement retenir que l’apparence donnée ne peut pas être corrigée par l’évocation d’une éventualité, à laquelle le juge ne semble pas donner de réelles chances, mais qu’il avance à la seule fin de rattraper une affirmation laissant objectivement douter de sa partialité.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a choisi de ne pas s’arrêter sur une phrase ambigüe du juge, pour analyser plutôt l’ensemble de ses déclarations ainsi que son comportement général1. Cette conclusion est conforme à sa jurisprudence antérieure, plutôt restrictive en matière de récusation fondée sur des propos tenus par le juge avant et pendant le procès, en particulier au moment de la conciliation. Il est admis que lors d’une tentative de conciliation en cours de procès, au sens de l’art. 124 al. 3 CPC, le juge communique son évaluation provisoire de la situation, sous réserve de la décision formelle sur le litige2. On retient généralement comme critère le fait de savoir si le juge s’est déterminé « d’une manière telle que la suite de la procédure n’apparaît plus ouverte »3. Dans l’ATF 134 I 238, le Tribunal fédéral avait récusé un juge rapporteur, lequel avait spontanément contacté le représentant d’une partie pour lui communiquer son évaluation provisoire du dossier, ce qui pouvait être interprété comme une incitation à retirer le recours. Le Tribunal fédéral avait insisté sur le fait que la communication d’une évaluation provisoire de la cause ne devait pas entraîner la récusation4, mais que la prise de contact spontanée du juge avec un représentant était déterminante en l’occurrence5. Par ailleurs, la Haute Cour avait alors indiqué que la situation d’espèce, soit une procédure d’appel en droit pénal, différait de celle du juge civil souhaitant procéder à une tentative de conciliation6. Dans un rare arrêt portant précisément sur des déclarations du juge pendant une tentative de conciliation, au cours d’un procès qui s’est ensuite poursuivi, le Tribunal fédéral avait retenu que le juge qui indique qu’il estime que le risque du procès est particulièrement haut pour les parties, n’éveillait pas de soupçon de partialité7.
A notre sens, l’interprétation des déclarations du juge ainsi que l’application du droit et de la jurisprudence antérieure auraient donc suffi à trancher la présente cause.
Or le Tribunal fédéral ne s’est pas arrêté à cela : il a fourni, dans cet arrêt qu’il destine à la publication, de larges explications sur la position du juge conciliateur (cf. les consid. 6.2 à 6.2.13 résumés ci-dessus). Il y a donc lieu de s’attarder sur la portée de l’arrêt.
b. La portée de l’arrêt et les nuances manquantes
En citant la doctrine, le Tribunal fédéral retient certes qu’il existe un point de tension entre le souci du juge de convaincre les parties de concilier, respectivement d’accepter sa proposition, et la réserve qui s’impose à lui dans son évaluation du dossier8. Dans sa démonstration, ces deux intérêts ne sont toutefois pas mis sur un pied d’égalité : le premier l’emporte largement sur le second.
En effet, le Tribunal fédéral débute par un plaidoyer général en faveur de conciliation et ses avantages, tant pour les parties que pour l’efficacité des tribunaux9. Il rappelle en outre que les déclarations qui sont faites lors d’une audience de conciliation (art. 205 CPC), disposition applicable à une tentative de conciliation menée au cours de la procédure au fond, ne sont pas consignées et qu’elles ne pourront pas être utilisées par la suite10. Pour le Tribunal fédéral, il semble ensuite essentiel que le juge joue un rôle particulièrement actif11, qu’il détermine les faits du dossier et applique le droit pertinent, afin de faire des propositions convaincantes aux parties12, lesquelles le seront d’autant plus si elles sont précises13.
En parallèle, le Tribunal fédéral théorise l’existence de deux fonctions bien distinctes du juge : celle du juge délégué chargé de mener les parties à un accord (rôle de conciliateur) et la fonction d’autorité de jugement14. Lorsqu’il remplit la première fonction, la liberté de parole du juge doit être importante : le Tribunal fédéral ne réserve que les propos désobligeants, les marques d’antipathie/de sympathie, le manque de respect envers une partie, comme suscitant des doutes sur son impartialité, sans mentionner le fait de se prononcer de manière détaillée sur la cause15. Au contraire, il semble que le Tribunal fédéral considère cette démarche comme nécessaire à l’objectif de règlement consensuel du litige, allant jusqu’à affirmer que le juge n’a pas à dissimuler sa conviction derrière un voile de réserve16. Le Tribunal fédéral aurait cependant pu rappeler dans ce contexte que certaines déclarations au cours de la conciliation pourraient conduire à admettre une apparence de prévention, en particulier le fait pour le juge de retenir un fait comme prouvé alors qu’il devra être clarifié dans le procès à venir17.
Dans tous les cas, la distinction entre les fonctions conciliatrice et décisionnelle du juge ne peut pas aboutir à leur complet cloisonnement. Il n’est pas concevable qu’aucun soupçon de prévention ne surgisse, si le juge qui sera amené à décider du sort de la cause expose avec force sa conviction sur l’affaire avant les délibérés, en particulier au début de la procédure, avant même l’administration des preuves. Comme le relève la doctrine, les efforts du juge ne doivent pas non plus correspondre ou pouvoir être perçu comme une pression indue pour concilier18. A cet égard, on ne saurait non plus distinguer entre les parties représentées ou non. Même un plaideur expérimenté aura dans ce cas le sentiment d’un procès dont le sort est déjà joué et commencera à évaluer les chances de succès des voies de recours à sa disposition. Le critère consistant à se demander, de manière objective, si la procédure apparaît encore ouverte aux yeux des parties19 demeure essentiel et doit conduire à prononcer la récusation, même pour des déclarations faites lorsque le juge joue le rôle de conciliateur. Un cloisonnement des fonctions ne semble d’ailleurs pas correspondre à la vision du législateur qui a intégré, comme motif de récusation, à l’art. 47 al. 1 let. b CPC, le fait d’avoir agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme médiateur. L’art. 47 al. 2 let. b CPC indique quant à lui que la participation à la conciliation ne constitue pas « à elle seule » un motif de récusation. La distinction opérée par le législateur entre le rôle du médiateur et celui du juge conciliateur est importante. La cohérence entre les deux alinéas parle ainsi en faveur d’un juge autorisé à tenter la conciliation et à poursuivre la procédure en cas d’échec, mais devant conserver une réserve dans le cadre de cette conciliation. Le médiateur ayant un rôle spécifique, celui-ci est empêché d’intervenir à nouveau dans la procédure à un autre titre.
Par ailleurs, l’on peut s’interroger sur la compatibilité de l’injonction faite au juge de se prononcer avec conviction, certes de manière provisoire, sur les faits et le droit de la cause avec la maxime des débats (art. 55 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC), applicables aux procédures commerciales telles que celles d’espèce. Il nous semble particulièrement délicat de se prononcer en détails sur une affaire, sans mettre en lumière les éventuels manquements en matière d’allégations, de preuves ou de conclusions des parties. Déterminer et communiquer au début de la procédure, lors d’une audience d’instruction, quelle version des faits est la plus convaincante, mettra forcément en lumière les manquements des parties sur ces aspects. Il existe donc un risque de voir le juge dépasser son devoir d’interpellation (art. 56 CPC)20, en fournissant aux parties, le plus souvent représentées dans les litiges commerciaux, des informations indues.
Enfin, sous l’angle spécifique des méthodes de conciliation, le Tribunal fédéral semble faire de l’estimation précise des chances de succès du procès et de sa communication aux parties l’alpha et l’oméga d’une bonne tentative de conciliation. De notre point de vue, il faut souligner que le juge est particulièrement bien outillé pour inciter les parties à la conciliation, sans donner l’impression de préjuger : il jouit d’une position d’autorité singulière lui permettant de faire entendre raison à des parties campées sur des positions de principe ; la conciliation peut être l’occasion de faire intervenir des aspects extérieurs à la procédure (détermination du but réel de la procédure pour chacun21 ; éventuelles excuses des parties ; compensations de différentes natures, etc.) ; le juge peut informer/insister sur les coûts de la procédure, dont certaines offres de preuves, voire jouer sur l’importante marge de manœuvre dont il dispose pour les réduire si la procédure s’arrête par une transaction ; informer les parties sur la durée attendue de la procédure ; etc. Évoquer certains risques spécifiques de la procédure, notamment lorsque la position d’une partie repose sur des preuves qui pourraient s’avérer fragiles, comme des témoignages à venir ou une expertise dont le résultat paraît incertain, permet aussi de mettre en lumière le risque de la procédure sans préjuger de la décision finale, pleinement dépendante du résultat de l’administration des preuves à venir. Selon les besoins, le juge peut également recommander la médiation22.
En somme, les développements du Tribunal fédéral nous apparaissent pertinents pour mener une conciliation efficace par une autorité de conciliation au sens des art. 197 ss CPC, lorsque l’organisation judiciaire cantonale assure que le juge de la conciliation préalable ne sera pas amené à traiter de l’affaire sur le fond, si la conciliation échoue. Toutefois, il convient d’opérer une distinction entre cette situation et celle du juge qui, comme dans le cas d’espèce, tente une conciliation en cours de procédure (art. 124 CPC), mais devra mener le procès jusqu’à son terme et rendre une décision, si la conciliation échoue. La position du juge qui intervient aussi bien dans le cadre de la conciliation préalable que dans la procédure au fond dans un même dossier, comme la pratique le veut dans certains cantons23, peut être assimilée à ce dernier cas de figure. Dans cette configuration, il incombe au juge de conserver une réserve et une distance suffisante, de manière à ne pas laisser entendre que la procédure ne serait plus ouverte24. Or un examen détaillé de la cause, en faits et en droit, communiqué avec conviction aux parties, pourrait remettre en cause cette exigence de réserve.
Notes
- TF 4A_237/2025, du 4 août 2025, consid. 6.3. ↩
- ATF 146 I 30, consid. 2.4 ; TF 4A_265/2024, du 22 juillet 2024, consid. 2.3.1 ; Cf. TF 1B_248/2020, du 22 décembre 2020, consid. 5.2.2-5.3 : un commentaire déplacé du procureur, insuffisant pour retenir une apparence de prévention, doit toutefois être mis en relation avec d’autres comportement douteux antérieurs qui n’auraient pas non plus suffi à eux-seuls pour retenir un soupçon de partialité. ↩
- TF 4A_14/2023, du 9 mai 2023, consid. 3.1.3 et les références citées. ↩
- Cf. dans le même sens TF 4A_149/2018, du 7 mai 2018, consid. 4.2 ; TF 4A_424/2012, du 19 septembre 2012, consid. 3.2.2. ↩
- ATF 134 I 238, consid. 2.6 ; cf. pour un cas encore plus clair d’incitation au retrait de l’appel : ATF 137 I 227, consid. 2.1. ↩
- ATF 134 I 238, consid. 2.4. ↩
- TF 4A_424/2012, du 19 septembre 2012, consid. 3.2.2. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.7. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.1-6.2.3. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.4. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.9. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.5-6.2.6. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.7. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2, 6.2.8 et 6.2.10. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.10. ↩
- TF 4A_237/2024, du 4 août 2025, consid. 6.2.11 : « Folglich braucht die Gerichtsdelegation ihre Überzeugung nicht hinter einem Schleier von Vorbehalten zu verbergen, nur weil sie ansonsten befürchten müsste, von der unzufriedenen Seite als befangen abgelehnt zu werde ». ↩
- ATF 131 I 113, consid. 3.6 ; TF 5A_382/2007, du 25 février 2008, consid. 3.2.2 ; cf. pour une casuistique complète : CR CPC-Bohnet, art. 47 CPC N 29 et 41. ↩
- BSK ZPO-Gschwend, art. 124 CPC N 9 ; KuKo ZPO-Weber, art. 124 CPC N 17. ↩
- TF 4A_14/2023, du 9 mai 2023, consid. 3.1.3 et les références citées. ↩
- Cf. notamment : ATF 146 III 413, consid. 4.2 et les références citées. ↩
- Cf. En détails sur le diagnostic du conflit : Dike ZPO-Kaufmann/Kaufmann, art. 124 CPC N 42 ss. ↩
- Pour une analyse détaillée du conflit et des critères permettant de déterminer si celui d’espèce présente un terrain favorable pour la conciliation ou une autre voie : Dike ZPO-Kaufmann/Kaufmann, art. 124 CPC N 42 ss, 52 ss ; Kuko ZPO-Kiener, art. 47 ZPO N 19. ↩
- C’est notamment le cas dans le canton de Fribourg, bien que cela ne ressorte pas clairement de la loi, cf. art. 60 de la Loi sur la justice (RS/FR 130.1). ↩
- CR CPC-Bohnet, art. 47 CPC, N 41 ; PC CPC-Colombini, art. 47 CPC N 32 ; BSK ZPO-Gschwend, art. 124 CPC N 9 in fine ; KommZPO-Wullschleger, art. 47 CPC N 33. ↩