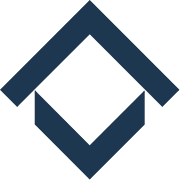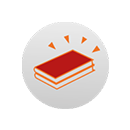Analyse de l’arrêt TF 5A_742/2024
29 juillet 2025
L’épée de Damoclès et le fil du rasoir : le sort de l’hypothèque légale indirecte dans la saisie immobilière
I. Objet de l’arrêt
Le Tribunal fédéral traite de la question des effets de la saisie d’un immeuble sur le droit d’un créancier à faire inscrire une hypothèque légale indirecte, in casu l’hypothèque légale pour charges de copropriété prévue à l’art. 712i CC. En l’espèce, l’hypothèque ne faisait l’objet d’aucune annotation ou inscription, mais avait été produite dans le délai de l’art. 138 al. 2 ch. 3 LP. La juridiction suprême en déduit que l’hypothèque légale indirecte ne peut être prise en considération par l’Office des poursuites au moment de rédiger l’état des charges.
II. Résumé de l’arrêt
A. Les faits et la procédure
Suite à la saisie d’une part de copropriété d’étage, l’Office des poursuites du canton de Genève (ci-après : l’office des poursuites) procéda à la publication de l’avis requis par l’art. 138 al. 2 ch. 3 LP. Dans le délai fixé pour la production des droits, la communauté des copropriétaires d’étages produit la somme totale de CHF 38’960.69, invoquant son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. Aucune inscription ou annotation de l’hypothèque ne ressortait du registre foncier. Ce nonobstant, la créancière estimait que « la reconnaissance directe à l’état des charges de sa créance lui permettait d’éviter des frais judiciaires et d’inscription au Registre foncier inutiles, les autres créanciers conservant la faculté de contester l’état des charges s’ils estimaient ses prétentions injustifiées » (consid. B.a.a).
Par lettre du 20 novembre 2023, l’office rejeta la production au motif qu’elle n’était étayée par aucune inscription au registre foncier. Une plainte au sens des art. 17 ss LP contre ce refus, ainsi que contre l’état des charges communiqué dans la foulée, fut rejetée le 17 octobre 2024 par la chambre de surveillance de la Cour de Justice du canton de Genève (consid. B.b.b).
La communauté des copropriétaires d’étages se pourvut devant le Tribunal fédéral. A l’appui de son recours, elle dénonçait la violation des art. 140 LP, 34 et 36 ORFI au motif que le droit à l’inscription d’une hypothèque légale indirecte, telle que l’hypothèque prévue par l’art. 712i CC, devait être porté à l’état des charges par l’office même sans inscription préalable au registre foncier (consid. 4). L’un des copropriétaires de la part de copropriété d’étages et l’office des poursuites conclurent au rejet du recours en matière civile. Le second copropriétaire ne déposa pas d’observations dans le délai requis et la Cour de Justice du canton de Genève se référa aux motifs de la décision querellée (consid. C). Par arrêt du 14 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
B. Le droit
Le Tribunal fédéral débute sa discussion juridique par rappeler les règles gouvernant la rédaction de l’état des charges d’un immeuble saisi (consid. 5.1.1 et 5.1.2) ainsi que le pouvoir d’examen différent dont bénéficie l’office selon qu’on se trouve en présence d’une réalisation intervenant dans le cadre d’une saisie ou d’une faillite (consid. 5.1.3). Cela l’amène à rappeler que les prétentions personnelles en constitution d’un droit réel ne peuvent figurer à l’état des charges (consid. 5.1.4). Il conclut ce premier pan de son analyse en indiquant que ce document est destiné à remplacer, pour les besoins de la procédure d’exécution forcée, l’extrait du registre foncier et qu’au regard de l’art. 49 al. 1 let. b ORFI l’absence de mention d’une hypothèque dans l’état des charges – quel qu’en soit le motif – a pour conséquence que celle‑ci ne passe pas à l’adjudicataire de bonne foi (consid. 5.1.5).
Après ces premières présentations relatives à la procédure de saisie immobilière, le Tribunal fédéral se tourne vers l’institution de l’hypothèque légale pour charges de copropriété instituée à l’art. 712i CC. Il expose que celle-ci ne prend pas naissance par effet de la loi, car cette dernière ne fait que conférer au créancier un droit à l’inscription du gage (consid. 5.2.1). Ce droit étant de nature personnelle, il ne peut être considéré comme un droit réel, ni même comme un droit renforcé. Il s’agit d’une obligation propter rem. Il en découle que l’hypothèque légale prend rang à la date de sa constitution, soit de son inscription au registre foncier, conformément à ce que prévoit l’art. 972 al. 1 CC (consid. 5.2.2).
Pour la mise en œuvre de l’hypothèque légale, soit le fait d’entraîner la réalisation du gage et le paiement de la dette garantie, une inscription au registre foncier est nécessaire, fût-ce à titre provisoire sur le fondement de l’art. 961 al. 1 ch. 1 CC. Dans ce cas de figure, si l’inscription définitive n’est pas opérée au moment de la rédaction de l’état des charges, la question sera tranchée au cours de la réalisation de celui-ci (consid. 5.2.3.1). Il s’ensuit que pour le Tribunal fédéral, il n’est pas possible de se limiter à faire valoir le droit à l’inscription au moment de la rédaction de l’état des charges dans le but de faire inscrire l’hypothèque après la réalisation de l’immeuble (consid. 5.2.3.2).
Si l’inscription provisoire peut avoir lieu une fois que la faillite du débiteur est ouverte, ou après la saisie de l’immeuble, elle n’en doit pas moins exister au moment où l’office établit l’état des charges (consid. 5.2.4.1 et 5.2.4.2). Sur ce point, l’espèce commentée tranche la question laissée ouverte dans un précédent arrêt du 12 novembre 19801. L’office est tenu de reporter à l’état des charges l’inscription provisoire ainsi opérée et les éventuelles contestations de la production doivent être liquidées dans le cadre de l’épuration de l’état des charges (consid. 5.2.5). En l’espèce, la partie recourante n’ayant produit dans le délai utile que son droit à la constitution de l’hypothèque légale indirecte, celle-ci n’ayant été inscrite qu’au cours de la procédure de plainte contre l’état des charges devant l’autorité cantonale de surveillance, l’office des poursuites n’était pas tenu de la prendre en considération (consid. 5.3), ce qui conduit au rejet de son recours en matière civile.
III. Analyse
A. L’épée de Damoclès
En conditionnant la prise en compte de l’hypothèque légale pour charges de copropriété au cours de la réalisation d’un immeuble à son inscription, fût-elle provisoire, le Tribunal fédéral interdit au créancier hypothécaire de s’en remettre au seul délai mentionné à l’art. 712i al. 1 CC. On peut parler d’une véritable épée de Damoclès que le droit de l’exécution forcée fait planer sur la communauté des copropriétaires d’étages, à qui il incombe d’agir au plus vite lorsqu’elle apprend la saisie d’une part de copropriété. Il lui faut, en effet, obtenir, au minimum, une inscription provisoire dans le délai utile pour produire sa créance, délai qui est de vingt jours dès la publication de l’avis de mise aux enchères2.
Il est légitime de s’interroger sur le bien-fondé de cette conséquence au vu de la générosité dont le législateur a fait preuve à l’égard de la communauté des copropriétaires d’étages. Alors qu’un bref délai de trois ou quatre mois3 doit être respecté pour les hypothèques légales indirectes mentionnées à l’art. 837 CC, et que les hypothèques légales directes de droit cantonal d’une valeur supérieure à mille francs doivent être inscrites dans les quatre mois suivant l’exigibilité de la créance garantie4, le législateur a laissé un délai5 de trois ans à la communauté des copropriétaires d’étages, délai qui lui paraissait alors suffisant pour ménager les intérêts légitimes d’un éventuel acquéreur6. Lors de l’introduction de la copropriété d’étages dans le Code civil, le bref délai assigné aux créanciers hypothécaires faisant valoir une des garanties instituées à l’art. 837 CC existait déjà et on est en droit de penser que le législateur a renoncé en toute connaissance de cause à un instituer un régime similaire à l’art. 712i CC. Le fait qu’ait été saisi le bien-fonds sur lequel l’hypothèque doit porter ne constitue pas une situation à ce point extraordinaire qu’elle justifierait de traiter de la même manière les deux gages immobiliers. En soumettant, dans la saisie, l’hypothèque légale pour charges de copropriété au même régime que l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le Tribunal fédéral traite de manière similaire des situations a priori différentes7.
Dans un arrêt antérieur, rendu le 6 février 19978, le Tribunal fédéral a esquissé ce qui pourrait être un commencement de justification à la sévérité dont il fait preuve à l’égard du créancier au bénéfice d’une hypothèque légale indirecte. L’affaire concernait l’opposabilité à l’acquéreur, sur le fondement de l’art. 649a CC, d’une disposition réglementaire prévoyant une responsabilité solidaire de l’acquéreur pour les charges de copropriété qui n’avaient pas été réglées par le vendeur. La part d’étage avait été acquise aux enchères suite à une saisie immobilière. En dépit du fait que l’arriéré ait été révélé aux enchérisseurs par la lecture d’une lettre adressée à l’office par l’administrateur de la copropriété, le Tribunal fédéral a rejeté l’application de la clause en question au motif qu’« admettre l’opposabilité d’une telle disposition réglementaire à l’ayant cause d’un propriétaire d'étages apparaît d’autant moins envisageable que, comme le relèvent avec pertinence les défendeurs, cela reviendrait à accorder à la communauté, en cas de réalisation forcée, un privilège injustifiable par rapport aux créances garanties par gage inscrites à l'état des charges », car « les enchérisseurs devraient nécessairement tenir compte, en enchérissant, de la dette qu’ils auraient ainsi à payer en sus du prix de vente, de sorte que celui-ci serait réduit d’autant, au détriment des créanciers gagistes ». En d’autres termes, le respect du principe de l’offre suffisante consacré à l’art. 126 LP impose de favoriser la hausse des enchères. Cela se comprend aisément au vu des conséquences d’une mise inférieure au montant des gages d’un rang supérieur à celui du créancier poursuivant : la poursuite s’éteint en application de l’art. 126 al. 2 LP auquel renvoie l’art. 142a LP. Il est donc nécessaire, et par voie de conséquence, raisonnable, de tout faire pour éviter d’en arriver là. Cela peut passer par une réduction au strict minimum des incertitudes causées par les hypothèques légales indirectes et conduire à suspendre une épée de Damoclès au-dessus de la tête des créanciers hypothécaires qui ne seraient pas encore inscrits au registre foncier.
De prime abord, l’approche suivie par le Tribunal fédéral paraît cohérente. L’art. 49 ORFI poursuit exactement le même but, soit de réduire au strict minimum le risque d’apparition de montants mis à charge de l’acheteur pour des faits antérieurs à l’adjudication. Cette disposition a d’ailleurs été formellement visée dans l’espèce commentée. En y regardant de plus près, il est toutefois permis d’éprouver quelques doutes concernant la nécessité de soumettre les hypothèques légales indirectes à un traitement aussi strict. Le second alinéa de l’art. 49 ORFI admet de faire supporter à l’adjudicataire d’« autres paiements en sus du prix de vente » à condition que ceux-ci soient mentionnés dans les conditions de vente. On peut en déduire que cette disposition fait perdre son caractère exhaustif à l’art. 49 al. 1 ORFI9. En somme, la seule maxime qu’on peut déduire de l’art. 49 ORFI est que l’adjudicataire est tenu de payer les montants mis à sa charge dans les conditions de vente et peut refuser tout autre paiement10. Transposée en matière d’hypothèque légale indirecte, cette approche devrait permettre d’opposer à l’adjudicataire, moyennant mention dans les conditions de vente, une hypothèque légale qui n’aurait pas encore été inscrite. A majore ad minus, on devrait aussi admettre que l’office prenne en compte une telle hypothèque, qui lui a été annoncée dans le délai de production, mais qui n’a été inscrite que postérieurement. C’est le lieu de rappeler que la saisie n’emporte pas le blocage du feuillet du registre foncier, mais uniquement la mention d’une restriction du droit d’aliéner le bien-fonds sur lequel elle porte (art. 960 al. 1 ch. 2 CC). Celle-ci n’empêche pas l’inscription d’une hypothèque légale indirecte après la rédaction de l’état des charges, même sans l’accord de l’office ou des autres créanciers. Les conséquences d’une telle inscription sont d’ailleurs réglées à l’art. 53 al. 3 ORFI : le créancier dernier venu ne peut se prévaloir du principe de l’offre suffisante, car son gage n’est pas pris en considération dans le calcul du prix de vente. A notre avis, la conséquence est déjà suffisamment grave pour qu’elle constitue une épée de Damoclès dont la lame est assez longue et lourde pour inciter le créancier à faire preuve de diligence. Un supplément de poids et de longueur, comme envisagé dans l’espèce commentée, n’est pas nécessaire. Une telle conclusion s’impose d’autant plus que la communauté des copropriétaires ne peut se prévaloir de l’art. 841 CC11. L’inscription tardive de son hypothèque n’est donc pas de nature à faire courir un risque aux créanciers gagistes antérieurs.
B. Le fil du rasoir
Outre l’épée de Damoclès dont il vient d’être question, l’espèce commentée oblige également la communauté des copropriétaires d’étages à se tenir constamment sur le fil du rasoir. A la différence des obligations garanties par les hypothèques légales indirectes de l’art. 837 CC, les charges de copropriété constituent des prestations périodiques. Cela signifie qu’elles arrivent à échéance à intervalle régulier. Sauf les cas évidents de mauvaise volonté – bien plus fréquents qu’on ne le pense – l’absence de règlement des charges de copropriété constitue généralement un indice sérieux des difficultés financières éprouvées par le copropriétaire d’étage. Un malheur n’arrivant jamais seul, la saisie de la part de copropriété pour une autre créance peut survenir à tout moment. Or une fois celle-ci effectuée, le compte à rebours commence et le fil rattachant l’épée de Damoclès à son support se fait chaque jour plus ténu12, jusqu’à se rompre à l’issue du délai de production de l’art. 138 al. 2 ch. 3 LP. Autant dire que face au défaut de paiement du copropriétaire, la communauté ne peut s’en remettre au délai de trois ans et attendre patiemment un retour à meilleure fortune, ou à de meilleurs sentiments. Toutefois, il faut aussi se garder de procéder dans la précipitation. Le droit à l’inscription de l’hypothèque légale pour des charges de copropriété échues, ne naît qu’après l’achèvement de l’exercice comptable au cours duquel les frais ont été encourus13. Il est donc possible que la saisie du bien immobilier intervienne avant l’échéance comptable. Ce cas de figure n’a pas été abordé par le Tribunal fédéral dans l’espèce commentée. La réalisation forcée de l’immeuble n’ayant pas les effets d’une purge hypothécaire au sens des art. 828 et 829 CC, même par les limitations de l’art. 49 ORFI, la communauté des copropriétaires d’étages doit pouvoir agir en inscription de son hypothèque légale contre le nouvel acquéreur. Quoi qu’il en soit, la communauté sera perpétuellement sur le fil du rasoir, car il ne lui suffira pas de vouloir procéder sans désemparer pour s’assurer du respect de ses droits.
Dans le monde nouménal des juristes, où les acteurs bénéficient perpétuellement de tous les moyens nécessaires, essentiellement en temps, en argent et en connaissance juridique, pour réaliser pleinement leurs droits, cette situation ne pose aucun problème. Il en va tout autrement dans la dure réalité de notre monde phénoménal. L’expérience générale de la vie14 enseigne que les procédures judiciaires ne sont pas systématiquement mises en œuvre dès la première défaillance de paiement d’un des copropriétaires. Cela s’explique avant tout par des considérations économiques. Il est rare que l’administrateur de la copropriété par étages soit en mesure de procéder personnellement aux démarches. Celles-ci sont presque toujours confiées à un avocat. Or le temps passé, et donc les honoraires, n’est que peu corrélé avec l’étendue de l’impayé. La rédaction de la requête ne prend, en effet, guère plus de temps qu’elle porte sur trois années de charges de copropriété plutôt que sur une seule. Il est donc plus économique d’attendre avant de saisir le tribunal. Cette sage règle de conduite a également pour conséquence d’éviter la multiplication des procédures lorsque la défaillance de paiement est durable. L’approche suivie par le Tribunal fédéral dans l’espèce commentée va toutefois à son encontre. Combinée avec la possibilité de faire inscrire une hypothèque légale pour les montants dus à titre d’avance15, cela risque de conduire à une multiplication des annotations et inscriptions concernant une même part d’étage. Il est loin d’être certain que cela contribuera à une meilleure mise en œuvre du droit, l’administrateur de la copropriété ayant certainement d’autres tâches plus intéressantes que le suivi des procédures. A cela s’ajoute le fait que les indemnités de dépens, octroyées sur le fondement du tarif cantonal visé à l’art. 105 al. 2 CPC, ne permettent que rarement de recouvrer l’intégralité des honoraires versés à l’avocat. La multiplication des procédures n’est pas dans l’intérêt économique de la communauté des copropriétaires d’étages.
Une des portes de sortie envisageables serait d’attendre la publication de l’avis de mise aux enchères pour demander – et obtenir sans grande difficulté – l’annotation d’une hypothèque légale à titre d’inscription provisoire octroyée sans audition de la partie adverse sur le fondement de l’art. 265 CPC16 comme cela est d’ailleurs envisagé dans l’espèce commentée (consid. 5.2.4.2). Cela implique de consulter régulièrement la feuille cantonale des avis officiels afin de ne pas passer à côté de la publication. Il est douteux que les gérances immobilières, qui assument fréquemment les tâches d’administrateurs de copropriété, possèdent le personnel suffisant. On ne peut les assimiler sans autre aux grandes structures capitalistes de notre économie, telles que les établissements bancaires ou les compagnies d’assurance pour lesquelles le dépouillement des publications officielles cantonales fait partie des tâches quotidiennes. Afin d’éviter les mauvaises surprises, il serait indiqué de prévoir par une modification de l’art. 15 ORFI que l’office des poursuites avertira l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages de la saisie, à tout le moins lorsque celui-ci a été mentionné au registre foncier par le jeu de l’art. 962a ch. 5 CC. Prévenu personnellement de la saisie de la part d’étage, l’administrateur pourrait entreprendre aussitôt les démarches judiciaires en vue de l’inscription à temps d’une éventuelle hypothèque légale pour charges de copropriété et ce avant même que l’avis de mise aux enchères ne soit publié. Cela garantirait tant le respect du délai utile que le recouvrement des charges de copropriété.
C. Conclusion
L’espèce commentée a répondu de manière claire à une question simple qui était restée ouverte depuis plus de quarante ans. C’est le grand mérite de cet arrêt, mérite auquel le caractère critiquable de la réponse donnée n’enlève rien. En revanche, il est indiscutable qu’en excluant l’inscription d’une hypothèque légale pour charges de copropriété après l’échéance du délai pour la production des charges au sens de l’art. 138 al. 2 ch. 3 LP, le Tribunal fédéral fait planer une authentique épée de Damoclès sur la communauté des copropriétaires. A supposer que l’administrateur de cette dernière souhaite agir à temps, il sera sans cesse sur le fil du rasoir, ne pouvant le faire avant la fin de l’exercice comptable, sauf si le règlement de copropriété a prévu le paiement d’avance, et devant y pourvoir au plus vite, une fois le droit à l’inscription né du fait de l’écoulement du temps. Afin d’adoucir quelque peu le sort de la communauté des copropriétaires d’étages, il serait envisageable de prévoir que l’administrateur, s’il est mentionné au registre foncier, soit prévenu de la saisie de la part de copropriété.
Dans l’espèce commentée, le Tribunal fédéral a soigneusement distingué entre la saisie immobilière et la réalisation de l’immeuble dans la faillite. Sans toutefois le dire en termes clairs et dépourvus d’ambiguïtés, il a laissé entendre que la procédure de vérification des créances – et le pouvoir d’examen reconnu à l’administration de la faillite de ce fait – autorisait l’administration de la faillite à tenir compte d’une hypothèque légale indirecte non encore inscrite, mais produite avec la créance (cf. consid. 5.1.3 et 5.4.2.2). Reste à voir si cette différence de traitement sera confirmée dans des arrêts ultérieurs ou si le Tribunal fédéral soumettra la reprise d’une hypothèque légale à l’état des charges prévu par l’art. 247 al. 2 LP aux mêmes conditions qu’en matière de saisie. L’affaire reste donc à suivre…
Notes
- ATF 106 II 183, consid. 3b. ↩
- Art. 138 al. 2 ch. 3 LP. ↩
- Cf. art. 838 et 839 al. 2 CC. ↩
- Art. 836 al. 2 CC. ↩
- Au plan strictement conceptuel, l’hypothèque légale pour charges de copropriété peut être inscrite en tout temps, mais au moment de chaque inscription, elle ne peut concerner que les trois derniers exercices : Paul Henri Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd., Berne 2019, p. 530 N 1904 et 1905. Concrètement, cela signifie qu’à la date de chaque inscription dans le registre foncier, l’hypothèque ne peut porter que sur les charges dues pour les trois derniers exercices comptables (CR CC II-Amoos Piguet, art. 712i CC N 9). L’effet pratique d’une telle restriction ne se distingue des conséquences de la péremption que sur la manière de computer le délai. Un droit se périme dans un certain délai après sa naissance. Cela signifie que la péremption est calculée à partir d’un événement passé en regardant vers l’avenir. L’art. 712i CC prévoit un calcul rétroactif en partant de l’événement présent, soit l’inscription au registre foncier, et en se dirigeant vers le passé. Mis à part cette distinction, plus métaphysique que juridique, il n’y a pas d’autre différence entre la péremption et l’impossibilité d’inscrire l’hypothèque légale en raison de l’échéance du délai triennal. ↩
- Cf. Message FF 1962 I 1498. ↩
- Ce qui est constitutif d’une inégalité de traitement prohibée par l’art. 8 Cst., cf. parmi tant d’autres : ATF 125 I 1, consid. 2b/aa. ↩
- ATF 123 III 53, consid. 3b. ↩
- En ce sens :commentaire ORFI-Kuhn, art. 49-50 ORFI N 9. ↩
- C’est apparemment la conclusion à laquelle le Tribunal fédéral est parvenu dans l’arrêt 5A_651/2015 du 25 janvier 2016, consid. 4.1.1. ↩
- Cf. Sylvain Marchand, Chacun chez soi, factures pour tous : la répartition des frais dans la propriété par étages, in : Hottelier/Foëx (édit.), Propriété par étages : fondements théoriques et questions pratiques, Genève 2003, p. 183. ↩
- L’art. 116 al. 1 LP prévoit un délai minimal de six mois entre la saisie et la réquisition de vente. ↩
- Amédéo Wermelinger, La propriété par étages – Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 4e éd., Rothenburg 2021, art. 712i CC N 65. ↩
- L’auteur de ces quelques lignes s’exprime tant en qualité de juge de première instance que de copropriétaire d’étage… ↩
- Amédéo Wermelinger, op. cit., art. 712i CC N 32. Il faut pour cela que le règlement d’administration et d’utilisation prévoie l’obligation de payer des avances et fixe l’échéance de paiement. ↩
- Bien que le Tribunal fédéral ait expressément indiqué que l’annotation d’une hypothèque légale provisoire sur le fondement de l’art. 961 CC ne constituait pas une mesure provisoire au sens des art. 261 ss CPC (cf. ATF 143 III 554), cela n’exclut pas le prononcé de mesures superprovisoires qui sont admises par la doctrine (Wermelinger, op. cit., art. 712i CC N 54) et couramment octroyées par les tribunaux. ↩