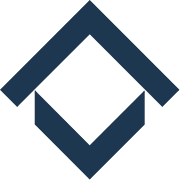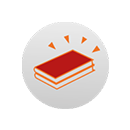Analyse de l’arrêt TF 2C_587/2023
27 mai 2025
Contrôle abstrait du droit cantonal des marchés publics : la marge de manœuvre laissée aux cantons par l’AIMP 2019 et le droit fédéral – Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2023 du 30 janvier 2025
I. Objet de l’arrêt
L’affaire 2C_587/2023 porte sur un recours en matière de droit public visant un contrôle abstrait des art. 9 et 10 de la nouvelle loi cantonale neuchâteloise sur les marchés publics (LCMP/NE). Les recourantes, une association faîtière d’entreprises de location de personnel ainsi que quatre sociétés actives dans ce secteur, sollicitent l’annulation de ces dispositions.
L’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal fédéral (TF) et son pendant du même jour, l’arrêt 2C_662/2023, amènent un éclairage substantiel sur la marge de manœuvre des cantons dans la mise en œuvre du droit harmonisé des marchés publics. Ces décisions ne se limitent pas à trancher la validité de dispositions cantonales neuchâteloises spécifiques, mais fournissent des éclaircissements fondamentaux sur l’articulation entre l’Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP 2019) et l’autonomie législative des cantons, ainsi que sur la manière d’intégrer des considérations de politique sociale dans ce cadre harmonisé.
La présente note examine, d’abord, le contexte et les faits pertinents de l’arrêt 2C_587/2023 (II/A). Elle expose, ensuite, le raisonnement juridique développé par le Tribunal fédéral (II/B). Enfin, elle s’achève par une analyse critique du sens, de la valeur et de la portée de cette décision dans l’ordre juridique suisse (III).
II. Résumé de l’arrêt
A. Les faits
Dans le sillage de l’adoption de l’AIMP 2019 le 15 novembre 2019, visant à harmoniser les règles de passation des marchés publics entre la Confédération et les cantons, le Grand Conseil neuchâtelois adopte le 5 septembre 2023 un décret d’adhésion à cet accord ainsi qu’une nouvelle loi cantonale sur les marchés publics (LCMP/NE). La LCMP/NE, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024, fait l’objet de contestations émanant de plusieurs parties.
L’arrêt 2C_587/2023 trouve son origine dans le recours en matière de droit public déposé le 23 octobre 2023 directement auprès du Tribunal fédéral par l’association A., qui défend les intérêts d’entreprises de services de l’emploi spécialisées notamment dans la location de personnel, et par quatre sociétés anonymes (B. SA, C. SA, D. SA, et E. SA) actives dans ce même domaine, y compris dans le secteur de la construction, et ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Neuchâtel. Les recourantes demandent l’annulation des art. 9 et 10 de la LCMP/NE, ou subsidiairement, la constatation que ces dispositions sont privées de tout effet juridique.
L’art. 9 LCMP/NE, intitulé « sous-traitance et location de personnel », est attaqué en particulier pour son alinéa premier qui autorise l’entité adjudicatrice à limiter ou exclure le recours à la sous-traitance ou à la location de personnel dans l’appel d’offres. Les alinéas suivants de cet article précisent les obligations des soumissionnaires, telles que l’indication de la part des prestations sous-traitées ou louées et l’identité des sous-traitants, l’exigence que les sous-traitants et sociétés de location de personnel remplissent les mêmes conditions de participation que le soumissionnaire principal, la nécessité d’approbation en cas de changement de sous-traitant en cours d’exécution, et une interdiction de principe de la sous-traitance au-delà du deuxième niveau.
L’art. 10 LCMP/NE, relatif au « travail temporaire », instaure quant à lui des restrictions spécifiques pour les marchés de construction. Il exige des soumissionnaires qu’ils justifient disposer du nombre d’employés nécessaires à la réalisation de la prestation, tenant compte des alinéas suivants (al. 1) et fixe des quotas précis pour le recours aux travailleurs temporaires sur un chantier, calculés en fonction de l’effectif d’employés fixes de l’entreprise (al. 2). Ces quotas varient d’un maximum de 2 travailleurs temporaires pour 1 à 3 employés fixes, jusqu’à un maximum de 20% de travailleurs temporaires pour les entreprises comptant 21 employés fixes ou plus. Le Conseil d’Etat se voit accorder la compétence de prévoir des exceptions (al. 3). Les recourantes dans cette affaire sollicitent et obtiennent l’effet suspensif pour les art. 9 et 10 LCMP/NE, le Grand Conseil neuchâtelois ayant acquiescé à cette demande. L’intimé, le Grand Conseil neuchâtelois, conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) renonce à déposer des observations.
Parallèlement à cette affaire, la cause 2C_662/2023 est initiée le 27 novembre 2023 par d’autres acteurs du secteur de la construction du canton de Neuchâtel, ainsi que deux de leurs associations faîtières, A. (regroupant des associations professionnelles du second œuvre) et B. (représentant des entreprises de maçonnerie et génie civil). Ces dernières ciblent d’autres dispositions de la LCMP/NE, à savoir l’article 6 alinéa 2, qui impose, pour les marchés de plus de 30’000 francs, aux soumissionnaires employant au moins 20 personnes et ayant des chances objectives d’obtenir le marché, de fournir une analyse vérifiée de l’égalité des salaires. Elles contestent également l’article 10 alinéa 1 (relatif à la justification du nombre d’employés nécessaires pour les marchés de construction, en lien avec les quotas de travail temporaire) et demandent la suppression du terme « exclure » à l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE.
Dans cette seconde affaire, l’effet suspensif est également octroyé pour l’article 6 alinéa 2, ainsi que pour les articles 9 et 10 LCMP/NE dans la mesure où cette demande n’était pas devenue sans objet à la suite de la décision sur l’effet suspensif prise dans la cause 2C_587/2023.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours le 30 janvier 2025.
B. Le droit
S’agissant de l’arrêt 2C_587/2023, le Tribunal fédéral aborde en premier lieu la recevabilité du recours (consid. 1). Il confirme sa compétence pour le contrôle abstrait de la LCMP/NE en vertu des articles 82 lettre b et 87 alinéa 1 LTF, puisqu’il s’agit d’un acte normatif cantonal non susceptible de recours cantonal (consid. 1.1). L’article 83 lettre f LTF, qui restreint le recours en matière de marchés publics, ne s’applique pas ici (consid. 1.1, citant ATF 145 I 26, consid. 1.1). La qualité pour recourir selon l’article 89 alinéa 1 LTF est reconnue aux sociétés de location de personnel (recourantes 2 à 5) en raison d’un intérêt virtuel digne de protection à l’annulation des dispositions contestées (consid. 1.2). L’association A. (recourante 1) bénéficie de la qualité pour agir par recours dit « corporatif égoïste », défendant les intérêts de ses membres (consid. 1.2, se référant à ATF 150 II 123, consid. 4.4, 137 II 40, consid. 2.6.4 et à l’arrêt 2C_661/2019, consid. 1.4.1 pour un cas similaire). Le dépôt du recours avant la promulgation de la loi n’est pas un obstacle à sa recevabilité (consid. 1.3, citant parmi d’autres l’ATF 136 I 17, consid. 1.2). L’examen se limite toutefois aux griefs motivés (art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2 LTF), soit l’article 9 alinéa 1 et l’intégralité de l’article 10 LCMP/NE, les autres alinéas de l’art. 9 n’étant pas critiqués de manière recevable (consid. 1.4).
Puis, le Tribunal expose les principes généraux du contrôle abstrait et l’établissement des faits (consid. 2). Il rappelle que son pouvoir d’examen pour violation du droit fédéral, international et intercantonal (art. 95 LTF) n’est pas limité à l’arbitraire, mais que les griefs de violation du droit intercantonal ou de droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF ; consid. 2.1, citant ATF 147 I 47, consid. 3.1 ; ATF 139 I 229, consid. 2.2). Dans le contrôle abstrait, le Tribunal fait preuve de retenue et cherche une interprétation de la norme conforme au droit supérieur (consid. 2.2, citant ATF 148 I 160, consid. 2 ; ATF 145 I 73, consid. 2). Les faits sont établis de manière autonome par le Tribunal si cela est nécessaire (art. 55 al. 1 LTF) (consid. 2.3, citant ATF 149 I 105, consid. 2.3).
Le Tribunal rejette ensuite les réquisitions de mesures d’instruction complémentaires (consid. 3) formulées par les recourantes (débats publics, auditions, expertises). Il note que le contrôle abstrait des normes n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH invoqué par les recourantes pour solliciter la mise en œuvre de ces mesures (consid. 3, citant ATF 147 I 478, consid. 2.4.2) et que les parties ont pu présenter amplement leurs arguments, le Tribunal disposant des éléments nécessaires pour statuer, notamment au vu de l’issue du litige concernant l’art. 10 LCMP/NE (consid. 3).
Abordant le fond (consid. 4 et 5), le Tribunal expose les griefs des recourantes qui invoquent des violations de la liberté économique (art. 27 Cst.), de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), de l’AIMP 2019 et des accords internationaux (consid. 4).
Il rappelle sa jurisprudence antérieure sur la location de personnel dans les marchés publics, notamment les arrêts 2C_661/2019 (droit tessinois et ALCP) et 2C_325/2023 (droit vaudois, LSE et liberté économique), tout en soulignant que l’examen de la conformité des normes cantonales à l’AIMP 2019 constitue une question nouvelle dans ces affaires (consid. 5).
L’examen principal porte sur la conformité des articles 9 alinéa 1 et 10 LCMP/NE à l’AIMP 2019 (consid. 6). Le principe de la primauté du droit intercantonal (art. 48 al. 5 Cst.) est réaffirmé (consid. 6.1, citant notamment l’ATF 138 I 435, consid. 1.3.2). L’AIMP 2019, qui vise l’harmonisation et la mise en œuvre de l’AMP révisé, est une réglementation détaillée (consid. 6.2, 6.3). L’article 63 alinéa 4 AIMP 2019 permet aux cantons d’édicter des « dispositions d’exécution ». Le Tribunal interprète cette notion restrictivement : de telles dispositions doivent avoir un « lien étroit » avec une norme de l’AIMP, la précisant ou assurant sa mise en œuvre, sans créer de nouvelles obligations (consid. 6.5, spéc. 6.5.1-6.5.3, se fondant sur l’interprétation littérale, systématique, historique, téléologique et la doctrine). Pour appliquer ce critère, le Tribunal distingue les conditions de participation (art. 26 AIMP/LMP), les critères d’aptitude (art. 27 AIMP/LMP), et les critères d’adjudication (art. 29 AIMP/LMP) (consid. 6.6.1, 6.6.2, citant notamment les ATF 145 II 249, ATF 140 I 285). Les critères d’aptitude doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné, définis au cas par cas (consid. 6.6.3, 6.6.4, citant le Message type AIMP et le Message LMP), et la sous-traitance peut être limitée pour de justes motifs (art. 31 AIMP/LMP) (consid. 6.6.5).
L’art. 10 LCMP/NE (quotas travail temporaire) est jugé non conforme à l’AIMP 2019 (consid. 6.8). Il n’est pas une concrétisation valable de l’art. 27 AIMP, car les quotas fixes ne respectent pas l’exigence de critères d’aptitude définis au cas par cas et objectivement nécessaires. Son objectif principal, révélé par les travaux préparatoires où il fut déclaré que la norme visait à « favoriser les emplois à durée indéterminée lors de l’adjudication des marchés de l’Etat, ce afin de contrer l’effet de précarisation induit par le travail temporaire », est la politique sociale (consid. 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3). Les arguments contraires du Grand Conseil sont écartés (consid. 6.8.4). L’art. 10 LCMP/NE est donc annulé (consid. 6.9).
En revanche, l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE (limitation/exclusion location de personnel) est jugé conforme à l’AIMP 2019 s’il est interprété comme permettant à l’adjudicateur de limiter ou exclure le recours à la location de personnel pour des motifs objectifs liés à la bonne exécution d’un marché spécifique, concrétisant ainsi l’article 27 AIMP. Le TF souligne que cela peut être le cas « lorsque la réalisation d’un ouvrage ou d’une prestation de service suppose une grande expérience et/ou un savoir-faire important des personnes censées y participer, compte tenu, notamment, de la spécificité du travail à effectuer (haute technicité, dangerosité, confidentialité, etc.) ou d’exigences de qualité de travail particulières se justifiant au regard de la prestation attendue » (consid. 6.7).
Le Tribunal examine ensuite la conformité de l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE au droit fédéral (consid. 7). Concernant la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE) et la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) (consid. 7.1), il est jugé compatible car il poursuit un « but différent » de la LSE (qui règle exhaustivement la location de services, voir ATF 120 Ia 89 ; arrêt 2C_325/2023), visant l’efficience des deniers publics et la qualité des prestations dans le cadre des marchés publics (consid. 7.1.1-7.1.3).
S’agissant de la liberté économique (art. 27 et 94 Cst.) (consid. 7.2), la disposition est conforme à l’art. 94 Cst. et la restriction à l’art. 27 Cst. est proportionnée (art. 36 Cst.) (consid. 7.2.1, 7.2.2).
Quant à la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI) (consid. 7.3), la conformité à l’AIMP induit une présomption de conformité à la LMI (art. 5 al. 1 LMI), les restrictions n’étant ni discriminatoires ni des barrières déguisées (consid. 7.3.1, 7.3.2).
Finalement, le Tribunal analyse la conformité de l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE au droit international (consid. 7.4). L’Accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce (AGCS) est inapplicable et l’Accord révisé sur les marchés publics (AMP révisé) est respecté (consid. 7.4.1). Aucune violation de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics et, enfin, de l’Accord, entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n’est constatée, la mesure étant proportionnée et distincte de l’interdiction générale sanctionnée dans l’arrêt du TF 2C_661/2019 (consid. 7.4.2).
En conclusion (consid. 8 et 9), le recours est partiellement admis : l’article 10 LCMP/NE est annulé, tandis que l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE est validé. Les frais et dépens sont répartis en conséquence (consid. 9).
Le sort de l’arrêt 2C_662/2023 est lié à celui de l’arrêt 2C_587/2023. Dans cette affaire parallèle, le Tribunal fédéral examine les recours d’entreprises de construction et de leurs associations contre les articles 6 alinéa 2, 9 alinéa 1 et 10 alinéa 1 LCMP/NE.
Concernant la recevabilité, le recours contre l’article 10 alinéa 1 LCMP/NE est déclaré sans objet (à la suite de l’arrêt 2C_587/2023) (consid. 1).
Au considérant 2, le Tribunal fédéral énonce les principes directeurs de son contrôle abstrait des normes cantonales, incluant l’étendue de son pouvoir d’examen (art. 95 LTF) et les exigences de motivation accrues pour certains griefs (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 2.1). Il y souligne également sa retenue inhérente à ce type de contrôle, la nécessité d’une interprétation conforme au droit supérieur, et sa compétence pour établir les faits de manière autonome (consid. 2.2, 2.3).
Les griefs des recourantes tendant à affirmer que les articles 6 alinéa 2 et 9 alinéa 1 de la LCMP/NE violent l’AIMP 2019, plusieurs lois fédérales, la liberté économique (art. 27 Cst.), et, concernant spécifiquement l’art. 9 alinéa 1 LCMP/NE, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) sont détaillés au considérant 3.
La qualité pour recourir d’une association faîtière est niée, mais admise pour les autres recourantes pour les articles 6 alinéa 2 et 9 alinéa 1 LCMP/NE. S’agissant de la conformité à l’AIMP 2019, l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE ne prête pas le flanc à la critique, y compris la limitation de la sous-traitance qui reflète l’article 31 AIMP, ce par identité de motifs à ce qui ressort de l’arrêt 2C_587/2023 (consid. 4). L’article 6 alinéa 2 LCMP/NE (analyse de l’égalité salariale) est aussi jugé conforme, constituant une modalité d’exécution admissible des articles 12 et 26 AIMP (consid. 4.7.2).
La conformité des articles 6 alinéa 2 et 9 alinéa 1 LCMP/NE au droit fédéral et international (consid. 5, 6, 7) est confirmée, en ligne avec le raisonnement de l’arrêt 2C_587/2023. Les restrictions à la liberté économique sont jugées proportionnées, y compris la charge administrative liée à l’article 6 alinéa 2 (consid. 5). La présomption de conformité à la LMI est maintenue (consid. 6). Le raisonnement du « but différent » pour la LSE/LTr et la compatibilité avec l’ALCP pour l’article 9 alinéa 1 est réitéré (consid. 7).
Le recours concernant la cause 2C_662/2023 est donc rejeté pour les points restants (consid. 8).
III. Analyse
A. L’harmonisation du droit des marchés publics : objectifs et limites de l’autonomie cantonale sous l’AIMP 2019
Conformément à l’article 3 de la Constitution fédérale (Cst.) [RS 101], les cantons exercent leur souveraineté dans les domaines non dévolus à la Confédération, ce qui s’applique notamment aux marchés publics. L’article 48 Cst. établit le cadre permettant ce « fédéralisme coopératif »1. Dans ce contexte, les conventions intercantonales – telles que l’Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP 2019) – se révèlent être des outils essentiels de l’harmonisation législative. La portée de l’article 48 alinéa 1 Cst. accordant aux cantons la latitude de conclure de tels accords et créer des organisations communes est avant tout déclarative2, puisque leur souveraineté et leur autonomie d’organisation découlent déjà des articles 3 et 47 alinéa 2 Cst.3. Par la suite, cette disposition définit les principes essentiels encadrant cette faculté, notamment en posant des limites (al. 3), tout en permettant la délégation de compétences législatives à des organes intercantonaux (al. 4) et en imposant aux cantons l’obligation de respecter le droit intercantonal (al. 5).
1. L’AIMP 2019 comme vecteur d’harmonisation substantielle
Adopté le 15 novembre 2019, en parallèle avec la nouvelle Loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 2019 (LMP) [RS 172.056.1], l’AIMP 2019 constitue une avancée décisive vers une harmonisation renforcée du droit des marchés publics en Suisse. Successeur de l’AIMP 1994, il vise à structurer le droit suisse des marchés publics en créant un « cadre général plus précis »4 que celui défini par la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI) [RS 943.02]. Pour ce faire, il harmonise autant que possible les règles applicables au niveau de la Confédération et des cantons, tout en respectant leurs compétences respectives, avec pour objectif d’unifier et de simplifier les bases légales fédérales et cantonales5.
L’AIMP 2019 se présente ainsi comme étant significativement plus détaillé que son prédécesseur et, conjointement avec la LMP, établit un corpus de règles largement exhaustif (« weitgehend abschliessende Erlasse »)6. Cette densification normative tend également à limiter la prolifération de dispositions d’exécution cantonales divergentes, afin de ne pas compromettre l’objectif d’harmonisation. Le Message type AIMP met d’ailleurs en garde que « l’objectif d’harmonisation de la législation entre cantons et Confédération visé par l’AIMP 2019 ne soit pas mis en péril par l’adoption de trop nombreuses dispositions d’exécution cantonales »7.
2. La notion restrictive des « dispositions d’exécution » cantonales (art. 63 al. 4 AIMP 2019)
L’interprétation de l’article 63 alinéa 4 de l’AIMP 2019 – autorisant les cantons à édicter des « dispositions d’exécution » – est au cœur de l’arrêt commenté. Cette disposition a été intégrée tardivement au projet d’accord, sur la demande expresse de quelques cantons pour qu’ils puissent adopter, s’ils le souhaitaient, une réglementation d’exécution similaire à celle que le Conseil fédéral était alors en train d’élaborer par le biais de la future ordonnance fédérale sur les marchés publics, notamment pour les articles 10 (exceptions à l’assujettissement), 12 (respect des conditions de travail et de l’environnement) et 26 (conditions de participation) de l’AIMP8.
Dans la continuité de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a adopté une interprétation restrictive de cette faculté. En effet, les normes cantonales doivent se borner à « exécuter » l’AIMP, c’est-à-dire en assurer la mise en œuvre concrète et la réalisation des buts – tout en établissant un lien étroit et substantiel avec une norme précise de l’accord – , afin de préciser sa portée ou d’en garantir l’application dans un sens déterminé. Une interprétation plus large, qui permettrait aux cantons d’exercer d’importantes compétences législatives, contreviendrait à l’objectif d’harmonisation poursuivi par l’AIMP 2019. En tant qu’acte « largement exhaustif », l’AIMP n’exige des interventions cantonales que des compléments ou des précisions ponctuelles. Ainsi, les dispositions d’exécution sont donc essentiellement de nature organisationnelle, d’application stricte ou de concrétisation des normes de l’AIMP. Elles ne doivent pas créer de nouveaux droits ou obligations pour les destinataires qui ne seraient pas déjà fondés, au moins implicitement, dans l’AIMP. Selon la doctrine citée par le TF, le droit cantonal ne devrait ainsi revêtir plus qu’une « portée secondaire »9, laissant aux cantons une marge de manœuvre « minimale » et « étroitement limitée »10.
Cette approche restrictive est également partagée par la doctrine en ce qui concerne l’adoption de dispositions par les organes intercantonaux. En commentant l’article 48 Cst., Waldmann/Schnyder von Wartensee ont relevé que l’exigence, imposée par le Parlement fédéral, de faire en sorte que les dispositions d’exécution « mettent en œuvre » une convention intercantonale (art. 48 al. 4 Cst.) avait pour but de limiter la compétence de ces organes à l’édiction d’un droit secondaire (Ausführungsrecht), même si le terme « umsetzen » figurant dans le texte de la loi pourrait, en principe, être interprété de manière plus large11. Les conditions de l’article 48 alinéa 4 Cst. – notamment l’approbation selon la procédure législative et la fixation des grandes lignes des dispositions – garantissent une légitimité démocratique suffisante pour de telles délégations. Dans ce contexte, Jeannerat estime toutefois qu’une interprétation de la « mise en œuvre » qui n’exclut pas totalement l’édiction de normes primaires par des organes intercantonaux reste envisageable, dès lors que la légitimité démocratique est assurée et que la convention habilitante (let. a) définit les grandes orientations des dispositions à édicter (let. b)12.
Spécifiquement, en ce qui concerne la portée de l’article 63 alinéa 4 AIMP 2019, Schneider Heusi souligne qu’en application de cette disposition les cantons disposent d’un « minimal Spielraum », c’est-à-dire d’une marge de manœuvre extrêmement restreinte13. De même, Clausen rappelle que cet article ne confère aux cantons qu’une compétence d’exécution limitée – essentiellement destinée à concrétiser les articles 10, 12 et 26 de l’AIMP – sans autoriser l’introduction de nouvelles obligations ou de droits non prévus par l’accord14.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle jurassienne, saisie par le Gouvernement jurassien d’un contrôle préventif de la Constitutionnalité et de la conformité au droit fédéral, a jugé, par l’arrêt CST 1/2023 du 14 décembre 2023, que l’article 15 alinéa 3 LMP-JU, qui introduisait les critères d’adjudication de la « fiabilité du prix » et de la « différence de niveau des prix », était incompatible avec l’article 29 de l’AIMP et l’objectif d’harmonisation. En effet, ces critères excédaient la marge de manœuvre autorisée par l’article 63 alinéa 4 AIMP15. La juridiction a ainsi précisé que l’énumération des critères d’adjudication prévue par l’article 29 de l’AIMP devait être considérée comme exhaustive quant aux catégories de critères admissibles. En d’autres termes, l’AIMP 2019 définit un cadre rigoureux que les cantons ne peuvent pas étendre via l’article 63 alinéa 4 précité, lequel demeure limité à la concrétisation des dispositions existantes, sans permettre l’ajout de nouveaux critères.
Ainsi, l’arrêt commenté s’inscrit dans cette lignée et réaffirme la primauté de l’harmonisation. On peut se demander si le Tribunal fédéral aurait pu, ou dû, préciser davantage les contours de ce « lien étroit » exigé ou fournir des balises plus concrètes pour distinguer une « disposition d’exécution » d’une « nouvelle obligation ». Une telle démarche aurait pu offrir une sécurité juridique accrue aux cantons. Toutefois, une définition excessivement prescriptive risquerait de figer l’interprétation et de brider indûment toute marge d’adaptation cantonale, même justifiée et conforme à l’esprit de l’AIMP. À l’inverse, une approche moins restrictive aurait ouvert la porte à des divergences cantonales potentiellement préjudiciables à l’harmonisation recherchée par l’AIMP 2019. La retenue du Tribunal fédéral, dans le cadre de ce contrôle abstrait, semble donc maintenir un équilibre délicat entre l’impératif d’harmonisation et la reconnaissance d’une sphère d’exécution, quoique minimale, aux cantons.
3. Le respect du droit intercantonal (et du droit fédéral) par les cantons (art. 48 al. 5 Cst.)
Dans l’arrêt commenté, le Tribunal fédéral fonde son analyse sur l’article 48 alinéa 5 de la Constitution, qui impose aux cantons de respecter le droit intercantonal. Cette disposition constitue la pierre angulaire assurant la force juridique de l’AIMP et sa supériorité par rapport à toute norme cantonale divergente. Même si le terme « respecte » (beachten) est employé plutôt que « prime » (afin d’éviter une primauté absolue au détriment des constitutions cantonales), il est généralement admis que le droit intercantonal directement applicable prévaut sur le droit cantonal16. En tant que convention intercantonale (art. 48 al. 1 Cst.), l’AIMP 2019 prime donc sur tout droit cantonal incompatible.
L’arrêt 2C_587/2023 réaffirme ce principe en annulant l’article 10 de la LCMP/NE pour non-conformité à l’AIMP. Cette hiérarchie normative est essentielle pour garantir une application uniforme de l’accord et pour atteindre ses objectifs d’harmonisation. Le Tribunal fédéral se voit ainsi chargé de dégager une interprétation unique des accords intercantonaux, afin d’éviter toute disparité dans leur application (consid. 2.1).
Le principe de la primauté du droit fédéral, consacré par l’article 49 alinéa 1 Cst., établit que toute norme cantonale – ou toute règle intercantonale non conforme au droit fédéral – qui contredit une norme fédérale est inapplicable. Ce principe, qui s’applique indépendamment du rang de la norme en cause, garantit la cohérence de l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, l’article 49 alinéa 2 Cst. confère à la Confédération la responsabilité de veiller à cette conformité17.
La primauté du droit fédéral constitue une condition essentielle au bon fonctionnement de l’État fédéral18. Elle ne remet pas en cause la compétence des cantons, mais la limite lorsque le législateur fédéral exerce sa compétence de manière exhaustive ou lorsqu’un conflit normatif direct se présente. Ainsi, en cas de conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, ce dernier doit céder la place au premier (« Bundesrecht bricht kantonales Recht ») (art. 49 al. 1 Cst.)19. Cette règle s’applique tant lorsque l’application simultanée de deux normes est impossible que lorsque le droit fédéral entend réglementer une matière de manière exhaustive. Les autorités cantonales, quant à elles, sont tenues d’examiner rigoureusement la conformité du droit cantonal au droit fédéral.
B. La qualification des exigences sociales dans les marchés publics : entre politique sociale et critères techniques
Traditionnellement axé sur la concurrence et l’efficacité économique, le droit des marchés publics intègre désormais de plus en plus des objectifs dits « secondaires » ou « politiquement urgents », tels que la durabilité et la lutte contre la corruption. La révision de la LMP, et par extension de l’AIMP, consacre la durabilité comme un objectif transversal, défini comme « l’usage économiquement, socialement et écologiquement responsable des fonds publics » (art. 2 lit. a LMP). La doctrine évoque ainsi un véritable « changement de paradigme » dans la qualification des exigences sociales au sein des marchés publics20.
1. La distinction fondamentale : critères d’aptitude, conditions de participation et critères d’adjudication
L’arrêt 2C_587/2023 insiste sur l’importance de distinguer clairement les différentes catégories d’exigences imposées aux soumissionnaires. Dans ce contexte, trois types de critères se distinguent21 :
- Les critères d’aptitude (Eignungskriterien) (art. 27 AIMP 2019) : ils visent à vérifier que le soumissionnaire possède les qualifications nécessaires – qu’elles soient professionnelles, financières, économiques, techniques, organisationnelles ou liées à l’expérience – pour exécuter correctement le marché. Ces critères doivent être objectivement indispensables et vérifiables pour le marché concerné, et sont parfois définis comme essentiels ou cruciaux pour sa réalisation. L’adjudicateur les détermine au cas par cas, en lien direct avec la prestation à accomplir. Un manquement à ces exigences conduit inévitablement à l’exclusion de l’offre.
- Les conditions de participation (Grundvoraussetzungen ou Teilnahmebedingungen) (art. 26 AIMP 2019) : elles imposent aux soumissionnaires le respect d’obligations générales, qui ne sont pas directement reliées à l’objet spécifique du marché. Parmi ces obligations figurent le paiement des impôts et des cotisations sociales, ainsi que le respect des normes relatives à la protection et aux conditions de travail, à l’égalité salariale, sans oublier les exigences en matière d’environnement et de concurrence22. Pärli classe le respect des conditions de travail et de la protection des travailleurs (art. 12 AIMP) dans cette catégorie23. Ces conditions, telles que le respect des salaires minimaux légaux ou conventionnels étendus et des conditions de travail usuelles, sont directement applicables. Leur non-respect peut aussi entraîner l’exclusion24. La législation sur les marchés publics prévoit régulièrement la vérification de l’égalité salariale et le respect des conditions de travail comme conditions de participation.
- Les critères d’adjudication (Zuschlagskriterien) (art. 29 AIMP 2019) : Ces critères ne concernent pas le profil du soumissionnaire, mais la qualité de la prestation proposée. Ils permettent de désigner l’offre la « plus avantageuse ». Bien que le non-respect d’un critère d’adjudication ne soit pas éliminatoire en soi, il peut être compensé par d’autres éléments. Ces critères peuvent notamment intégrer des aspects favorisant le développement durable.
Cette distinction est fondamentale car la validité de l’exigence dépend de sa correcte qualification juridique.
2. L’article 10 LCMP/NE : Sanction d’une mesure de politique sociale déguisée en critère d’aptitude
L’annulation de l’article 10 LCMP/NE, qui imposait des quotas stricts de travailleurs temporaires dans les marchés de construction, illustre de manière frappante l’application rigoureuse de la distinction entre critères d’aptitude et mesures d’exécution. Le Tribunal fédéral a constaté que cette norme visait explicitement à favoriser les emplois à durée indéterminée et à contrer l’effet de précarisation induit par le travail temporaire. En conséquence, ces quotas stricts et généraux ne répondent pas objectivement aux exigences de bonne exécution des marchés et ne peuvent donc être qualifiés ni de critères d’aptitude au sens de l’article 27 AIMP 2019, ni de « disposition d’exécution » valable au sens de l’article 63 alinéa 4 AIMP 2019.
De manière analogue, dans l’affaire tessinoise évoquée par l’arrêt commenté (arrêt du TF 2C_661/2019 du 17 mars 2021), le TF avait examiné une disposition cantonale (art. 24 LCPubb/TI) interdisant de manière générale la sous-traitance et l’emploi de personnel fourni par des tiers. Le Tribunal fédéral a annulé la mention « e/o l’impiego di personale fornito da terzi », considérant qu’une interdiction générale et absolue de recourir à du personnel mis à disposition excédait ce qui est admissible au regard de la liberté économique (art. 27 Cst.), de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)25.
Bien que cette décision porte sur une interdiction plutôt que sur des quotas, sa logique rejoint celle de l’arrêt 2C_587/2023 : les mesures cantonales affectant l’emploi de personnel doivent être étroitement liées aux exigences spécifiques du marché et ne pas masquer une politique sociale.
En outre, à l’arrêt commenté, le Tribunal fédéral a distingué cette situation de celle de l’ATF 140 I 285, laquelle concernait des critères d’adjudication sociaux sous l’AIMP 1994, et non des critères d’aptitude. Pour le TF, les quotas imposés par l’article 10 LCMP/NE empiètent sur la compétence d’exécution cantonale en instaurant une condition d’aptitude générale qui n’est pas prévue par l’AIMP.
3. La durabilité sociale dans l’AIMP 2019 : canaux adéquats
L’annulation de l’article 10 de la loi neuchâteloise sur les marchés publics (LCMP/NE) du 5 septembre 2023 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_587/2023 du 30 janvier 2025) ne remet pas en cause les objectifs sociaux en tant que tels. Elle critique la méthode utilisée – à savoir, l’imposition de quotas rigides pour le travail temporaire dans la construction – jugée incompatible avec l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP). Le Tribunal fédéral a estimé que de telles limites systématiques, bien que poursuivant un but de politique sociale de protection des travailleurs, ne constituaient pas une concrétisation admissible de l’article 27 AIMP relatif aux critères d’aptitude, car elles n’étaient pas objectivement nécessaires pour l’exécution de chaque marché concerné. L’AIMP 2019 intègre en effet des considérations de durabilité et de justice sociale, mais oriente les cantons à traduire leurs objectifs politiques à travers les mécanismes prévus : les critères d’aptitude, les conditions de participation et les critères d’adjudication. La Loi bernoise concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics (LAIMP BE) du 8 juin 2021 (RS BE 731.2) énonce ainsi explicitement le respect des exigences du développement durable comme l’un de ses buts (art. 1 LAIMP BE).
Conditions de participation (Art. 12 et 26 AIMP) : Le socle social et environnemental :
L’article 12 AIMP 2019, par exemple, impose le respect des conditions de travail, de l’égalité salariale et des normes environnementales comme conditions de participation au marché. Ces exigences se traduisent concrètement par le respect des conventions collectives de travail (CCT), des dispositions protégeant les travailleurs et des salaires usuels. Le contrôle de ces obligations repose sur des déclarations des soumissionnaires, associées à des vérifications par l’adjudicateur26.
Plusieurs cantons, dont les cantons romands, ont précisé ces exigences : la Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 14 juin 2022 (BLV 726.01) prévoit que les conditions de travail fixées dans une convention collective de travail dont le champ d’application est étendu au canton de Vaud et dont les termes ne connaissent pas leur équivalent au siège ou à l’établissement en Suisse du soumissionnaire ou de ses sous-traitants leur sont applicables lorsqu’ils fournissent des prestations dans le canton de Vaud et que l’application de ces conditions de travail répond à un intérêt public prépondérant, tel que la protection contre le dumping social (art. 8 al. 1 LMP-VD). Elle permet aussi d’exiger un système de contrôle du personnel (art. 8 al. 2 et 3 LMP-VD). La Loi fribourgeoise sur les marchés publics (LCMP FR) du 2 février 2022 (RS FR 122.91.1) impose la consultation des organes paritaires avant l’adjudication (art. 6 LCMP FR) et exige, pour la construction, un système de contrôle par carte professionnelle ou équivalent (art. 7 LCMP FR). La Loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (LCAIMP VS) du 15 mars 2023 (RS VS 726.1) exige que le soumissionnaire prouve le respect des conditions de participation pour lui-même et ses sous-traitants, via une déclaration sur un document officiel et la transmission d’attestations avant adjudication (art. 8 LCAIMP VS). Elle précise que le respect des CCT est attesté par les commissions paritaires (art. 8 LCAIMP VS) et détaille le respect des conditions de travail (CCT/CTT ou salaires usuels) ainsi que la surveillance contre la sous-enchère salariale (art. 9 LCAIMP VS). Ces déclarations et attestations sont régies par l’Ordonnance sur les marchés publics (OCMP VS) du 29 novembre 2023 (RS VS 726.100) (art. 2 et 3 OCMP VS). L’OAIMP BE impose à l’adjudicateur de vérifier une liste détaillée de justificatifs (Art. 7 OAIMP BE).
Dans le canton de Genève, dont l’adhésion à l’AIMP 2019 est toujours à l’examen, le Règlement sur la passation des marchés publics (RMP GE) du 17 décembre 2007 (RS GE L 6 05.01) exige des attestations couvrant les assurances sociales, le respect des CCT ou les usages genevois, l’impôt à la source et l’égalité (art. 20 et 32 RMP GE).
À cet égard, la Chambre constitutionnelle genevoise (ACST/3/2023 du 16 février 2023) a validé ces dernières dispositions du RMP GE qui concrétisent les obligations (identiques) de l’article 12 LMP, estimant que « le respect des conditions de travail usuelles du lieu d’exécution de la prestation […] fait partie intégrante des conditions de participation » (consid. 5.3.2 ACST/3/2023).
Enfin, à l’arrêt 2C_662/2023 du 30 janvier 2025, le Tribunal fédéral a confirmé l’exigence relative à l’égalité salariale – inscrite à l’article 6 alinéa 2 LCMP/NE – comme une condition de participation (art. 26 AIMP) dont la preuve peut être exigée.
Sous-traitance : encadrement cantonal et interprétation fédérale
L’obligation de répercuter les exigences de l’article 12 AIMP aux sous-traitants (art. 12 al. 4 AIMP) est renforcée par des règles cantonales strictes sur la sous-traitance. L’interdiction de principe de la sous-sous-traitance (ou double sous-traitance) est ainsi prévue dans les cantons de Vaud (art. 5 LMP-VD), Fribourg (art. 4 LCMP FR), Jura, dans la Loi concernant les marchés publics (LMP-JU) du 6 septembre 2023 (RS JU 174.1) (art. 5 LMP-JU), Valais (art. 11 LCAIMP VS) et Genève (art. 35 RMP GE), sauf exceptions motivées.
L’arrêt commenté 2C_587/2023 du Tribunal fédéral, annulant l’article 10 LCMP/NE qui fixait des quotas, a confirmé la validité de l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE. Cette disposition permet à l’entité adjudicatrice de limiter ou d’exclure le recours à la location de personnel dans l’appel d’offres. Le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle faculté, exercée au cas par cas et justifiée par les besoins spécifiques du marché (haute technicité, dangerosité, confidentialité, exigences de qualité particulières nécessitant un personnel fixe expérimenté), peut constituer une concrétisation admissible de l’article 27 AIMP relatif aux critères d’aptitude. La même logique peut s’appliquer à la limitation ou exclusion de la sous-traitance prévue à l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE, qui reflète l’article 31 AIMP.
En revanche, une restriction systématique et législative des quotas de travailleurs temporaires, déconnectée des besoins spécifiques de chaque marché et motivée par des objectifs de politique sociale générale, outrepasse la marge de manœuvre cantonale sous l’AIMP.
Critères d’adjudication sociaux et environnementaux
L’article 29 alinéa 2 AIMP 2019 ouvre la voie à des critères d’adjudication sociaux spécifiques pour les marchés non soumis aux accords internationaux. Lorsqu’un critère social tel que la formation d’apprentis est admis, sa pondération doit rester limitée (maximum 10 %)27. L’emploi de chômeur de longue durée ou de personnes issues d’une autre action de lutte contre le chômage est également un critère admissible28.
Le canton du Valais, par exemple, permet d’utiliser la formation professionnelle initiale comme critère (art. 12 OCMP VS). Le canton de Genève autorise la prise en compte de l’engagement en faveur de l’emploi (demandeurs d’emploi, personnes handicapées, stabilité du personnel) (art. 43 RMP GE).
D’autres dispositions de l’AIMP permettent d’intégrer des aspects sociaux et environnementaux, comme l’utilisation de matériaux certifiés (écolabel) ou la prise en compte des coûts du cycle de vie (LCC). Fribourg exige le respect de labels spécifiques (SNBS, Bois Suisse, Ange Bleu) (art. 8 LCMP FR) et assure un monitoring de la durabilité (art. 9 LCMP FR). Vaud encourage l’utilisation du Label Bois Suisse (art. 9 LMP-VD). Berne impose la prise en compte de la durabilité et des coûts du cycle de vie via l’Ordonnance du 5 novembre 2014 sur l’organisation des marchés publics (OOMP BE) (RSB 731.22) (art. 6a OOMP BE). Le Valais contrôle la prise en compte du développement durable par des exigences techniques ou des critères (art. 15 LCAIMP VS) et met à disposition un outil de calcul carbone (art. 15 LCAIMP VS). L’invalidation par la Cour constitutionnelle jurassienne (arrêt CST1/2023 du 14 décembre 2023) des critères « fiabilité du prix » et « différence de niveau des prix » (art. 15 al. 3 LMP- JU) illustre la réticence à accepter des ajouts de critères d’adjudication ne s’inscrivant pas dans l’esprit de l’article 29 AIMP29.
Pour être efficaces, ces critères doivent être étroitement liées à l’objet du marché, proportionnées et non-discriminatoires30. De Rossa Gisimundo met en garde contre le risque que les objectifs de durabilité soient détournés en instruments de protectionnisme31, citant l’exemple de la loi tessinoise (arrêt du TF 2C_661/2019 du 17 mars 2021) qui, en assimilant restrictivement le prêt de personnel à la sous-traitance, avait été jugée partiellement contraire à l’ALCP. Pour assurer l’effectivité, des peines conventionnelles sont prévues (art. 7 LMP-VD, Art. 13 LMP-JU, Art. 5 LCMP FR, Art. 12 LCAIMP VS, Art. 5 OAIMP BE).
En définitive, en annulant l’article 10 LCMP/NE, le Tribunal fédéral (arrêt 2C_587/2023) a clairement indiqué que les objectifs de politique sociale ne sauraient être introduits par le biais de critères d’aptitude généraux et fixes, étrangers à la nécessité objective d’exécuter un marché spécifique. Si l’arrêt se concentre sur la non-conformité de la disposition attaquée, il offre néanmoins, en validant l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE, une illustration des voies que l’AIMP 2019 permet pour l’intégration de tels objectifs. L’analyse doctrinale et l’arrêt parallèle 2C_662/2023 confirment l’existence de ces canaux légitimes (notamment les articles 12, 26 et 29 al. 2 AIMP).
C. La règlementation de la location de services dans les marches publics cantonaux (art. 9 al. 1 LCMP/NE)
1. Validation sous conditions strictes
Le TF a validé l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE, qui autorise la limitation ou l’exclusion de la location de personnel, à la condition expresse que cette mesure soit justifiée, au cas par cas, par la nécessité objective d’assurer la bonne exécution d’un marché spécifique. Autrement dit, la mesure doit être « dûment justifiée » par l’autorité adjudicatrice (consid. 6.7). Elle constitue ainsi une concrétisation admissible des dispositions de l’article 27 AIMP (critères d’aptitude) et de l’article 31 AIMP (concernant la sous-traitance). Cette nécessité peut découler, par exemple, de la nature particulière d’une prestation – haute technicité, dangerosité ou confidentialité – ou encore d’exigences qualitatives spécifiques.
Dans une affaire vaudoise, le TF a confirmé l’arrêt de la Cour constitutionnelle vaudoise (arrêt du 1er mai 2023) en validant une disposition similaire (art. 6 LMP-VD). Il a réitéré que de telles limitations sont admissibles si elles reposent sur des motifs objectifs liés à la bonne exécution du marché, justifiées au cas par cas et qu’elles ne traduisent pas une interdiction générale et abstraite. Le TF insiste ainsi sur la nécessité pour l’autorité adjudicatrice de démontrer « l’existence d’un besoin concret et prouvé »32. Cette jurisprudence est cohérente avec l’arrêt neuchâtelois rapporté.
Avant l’AIMP 2019, la Chambre constitutionnelle genevoise (ACST/28/2018) avait annulé certaines restrictions à la sous-traitance (art. 33 al. 2 et 35A RMP) jugées trop générales. Elle avait alors souligné qu’une interdiction générale de la sous-traitance ou de la location de services « n’est pas admissible » et que des limitations ne pouvaient être envisagées que pour des « motifs techniques ou qualitatifs », anticipant ainsi la nécessité d’une justification adaptée au cas par cas en fonction de l’objet du marché33.
Si cette validation conditionnelle de l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE est juridiquement fondée sur une interprétation conforme de l’article 27 AIMP, sa mise en œuvre pratique soulève des interrogations. Le Tribunal fédéral insiste sur la nécessité pour l’autorité adjudicatrice de démontrer « l’existence d’un besoin concret et prouvé ». La difficulté résidera dans la capacité et la volonté des entités adjudicatrices à appliquer ce critère avec la rigueur exigée. Il existe un risque que cette disposition, malgré les balises posées, soit invoquée pour des motifs moins objectifs ou pour masquer des considérations de politique sociale locales, voire un certain protectionnisme. Une vigilance particulière sera donc nécessaire pour s’assurer que les « justes motifs » ou les « motifs objectifs » ne deviennent pas des clauses de style vidées de leur substance. Le Tribunal fédéral aurait-il pu imposer des garde-fous procéduraux plus stricts ou des critères de justification encore plus précis ? Cela aurait pu complexifier le contrôle abstrait, mais potentiellement limiter les risques d’application extensive en pratique.
2. Compatibilité avec le droit fédéral et les accords internationaux
Pour assurer l’harmonisation et la légitimité des réglementations cantonales en matière de marchés publics, il convient d’examiner leur compatibilité avec le droit fédéral et les engagements internationaux :
- Loi fédérale sur le service de l’emploi (LSE, RS 822.11) : Le Tribunal fédéral a réaffirmé que, même si la LSE réglemente de manière exhaustive la protection des travailleurs intérimaires, les cantons conservent la compétence, dans le cadre des marchés publics, d’adopter des dispositions susceptibles d’impacter cette activité. Toutefois, ces mesures doivent poursuivre un « autre but que celui recherché par la LSE » – par exemple, l’efficience des deniers publics ou l’amélioration de la qualité – et ne doivent en aucun cas contredire la LSE. Sous cet angle, l’article 9 alinéa 1 de la nouvelle Loi cantonale sur les marchés publics a été jugé conforme.
- Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02) : L’article 9 alinéa 1 LCMP/NE, interprété comme une concrétisation de l’article 27 de l’AIMP, bénéficie de la présomption de conformité à la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), conformément à l’article 5 alinéa 1 LMI. L’expertise de la COMCO du 21 octobre 2019 concernant l’admissibilité du principe du lieu d’exécution pour les conditions de travail dans le droit cantonal des marchés publics (622-00004) souligne que, pour les marchés publics cantonaux, la LMI impose par défaut le respect du principe du lieu de provenance s’agissant des conditions de travail34. Une règle cantonale instaurant de manière générale le principe du lieu d’exécution serait donc contraire à la LMI35. L’expertise n’exclut pas l’application du principe du lieu d’exécution uniquement de manière exceptionnelle et au cas par cas36, si les conditions restrictives de l’article 3 LMI sont remplies (mesure indispensable à la préservation d’intérêts publics prépondérants, proportionnée, non discriminatoire37 et visant par exemple à lutter contre le dumping social en l’absence de prescriptions équivalentes au lieu de provenance)38. Le fait que la nouvelle LMP ait adopté le principe du lieu d’exécution pour les marchés de la Confédération ne modifie pas cette primauté du principe du lieu de provenance pour les cantons au regard de la LMI39. Il est rappelé que l’article 5 alinéa 1 LMI s’applique à l’ensemble des marchés40, indépendamment de leur valeur, et garantit un accès inconditionnel41 sans aucune réserve de réciprocité pouvant être opposée aux soumissionnaires établis en Suisse. Seules les restrictions fondées sur les exigences impératives de l’article 3 LMI sont admissibles42, et toute exclusion ou préférence fondée notamment sur le lieu de domicile ou d’établissement – comme la prise en compte du paiement d’impôts dans le canton ou l’inscription à un registre professionnel cantonal – est prohibée43.
- Liberté économique (articles 27 et 94 de la Constitution fédérale) : Les restrictions introduites par l’article 9 alinéa 1 LCMP/NE ont été jugées conformes aux principes de liberté économique consacrés par les articles 27 et 94 Cst., dès lors qu’elles sont justifiées par un intérêt public et proportionnées, en application de l’article 36 Cst.
- Accord sur les marchés publics révisé et Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) : La mesure, si elle est proportionnée et poursuit un but légitime – c’est-à-dire la bonne exécution du marché – ne viole pas les engagements pris dans le cadre de l’Accord sur les marchés publics révisé ni dans celui de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le Tribunal fédéral a, dans ce contexte, distingué la situation de celle examinée dans l’ATF 2C_661/2019 (Tessin), tout en rappelant la possibilité d’introduire des limitations ponctuelles justifiées. Par ailleurs, l’Accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce (AGCS) est inapplicable à la problématique des marchés publics (cf. arrêt 2C_587/2023, consid. 7.4.1, citant l’art. XII par. 1 AGCS). Les arrêts du Tribunal fédéral 2C_661/2019 et 2C_325/2023 confirment implicitement cette analyse lorsque les conditions restrictives élaborées par le Tribunal sont respectées.
Ainsi, en respectant scrupuleusement ces cadres juridiques, les mesures cantonales s’inscrivent dans une logique de concurrence équitable et contribuent à la mise en œuvre efficace des marchés publics.
D. Divergence : Principe du lieu d’origine (AIMP/LMI) VS lieu de prestation (LMP) pour les conditions de travail
Une divergence fondamentale subsiste entre la Loi sur les marchés publics (LMP) révisée et l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) en ce qui concerne les conditions de travail imposées aux soumissionnaires suisses.
Pour les marchés fédéraux, la LMP révisée (art. 12 al. 1) impose le respect des conditions du lieu de prestation. Malgré la proposition initiale du Conseil fédéral visant à harmoniser la LMP avec le principe du lieu de provenance, le Parlement fédéral a choisi de maintenir cette solution, optant ainsi pour une réglementation différenciée.
A l’inverse, pour les marchés publics cantonaux et communaux régis par l’AIMP, l’article 12 alinéa 1 AIMP, applicable aux soumissionnaires suisses, se conforme aux prescriptions de la Loi sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02 – notamment art. 2 et 5), qui consacre le principe du lieu de provenance. Selon la LMI, une entreprise suisse peut offrir ses prestations sur l’ensemble du territoire national en se conformant aux prescriptions en vigueur dans son canton d’origine, grâce à la présomption d’équivalence des réglementations cantonales (art. 2 al. 5 LMI). Imposer systématiquement les conditions du lieu de prestation constituerait une restriction disproportionnée. L’expertise du 21 octobre 2019 de la COMCO précise d’ailleurs qu’une règle générale dans l’AIMP imposant le lieu d’exécution aux entreprises suisses serait incompatible avec la LMI. Néanmoins, les cantons peuvent, à titre exceptionnel (cf. art. 2 al. 5 et art. 3 LMI), appliquer les conditions du lieu d’exécution pour prévenir un dumping social avéré, dès lors que les conditions du lieu de provenance ne sont pas équivalentes. Le Message du Conseil fédéral de 1994 relatif à la LMI indiquait déjà qu’une réglementation cantonale imposant le respect des conventions collectives de travail (CCT) du lieu d’exécution serait incompatible avec l’art. 5 LMI. Il convient également de noter que les soumissionnaires étrangers, dépourvus de siège en Suisse, ne peuvent invoquer le bénéfice de la LMI.
En ce qui concerne les travailleurs détachés, une entreprise soumissionnaire établie en Suisse participant à un marché public cantonal ou communal doit, en principe, respecter les conditions de travail de son lieu de provenance (cf. art. 2 al. 1 et 3, 3 al. 1 let. b et 3 al. 2 let. a LMI), sauf en cas de dumping social. Cette règle repose sur la présomption d’équivalence des conditions de travail entre les cantons (art. 2 al. 5 LMI)44.
Cette divergence est particulièrement pertinente pour comprendre les arrêts 2C_587/2023 et 2C_662/2023, le Tribunal fédéral devant s’assurer de la compatibilité des dispositions neuchâteloises avec la LMI. En effet, la réglementation neuchâteloise validée (art. 9 LCMP/NE) ne remet pas en cause le principe du lieu de provenance pour les aspects salariaux et poursuit un objectif légitime de bonne exécution du marché. L’annulation de l’article 10 LCMP/NE relatif aux quotas illustre, en revanche, la rigueur du Tribunal fédéral quant au respect par les cantons du cadre AIMP et des principes du droit fédéral supérieur, notamment ceux consacrés par la LMI. En effet, bien que l’art. 10 LCMP/NE ne portait pas directement sur les conditions salariales différenciées, son caractère de politique sociale outrepassant les compétences d’exécution cantonales aurait pu créer des distorsions indirectes contraires à l’esprit d’un marché intérieur harmonisé par l’AIMP et régi par la LMI pour les aspects non couverts explicitement par l’AIMP.
E. Perspectives et enjeux futurs
1. L’avenir des politiques sociales cantonales dans les marchés publics
L’arrêt rapporté confirme la latitude très limitée dont disposent les cantons pour édicter des règles s’écartant des principes directeurs de l’AIMP. D’ailleurs, l’arrêt commenté rappelle à maints endroits que l’AIMP 2019 vise une harmonisation du droit des marchés publics, tout en laissant une place aux particularismes cantonaux lorsque ceux-ci trouvent une justification directe et substantielle dans les objectifs et les dispositions de l’AIMP (cf. consid. A.a., consid. 6.2, 6.3 et 6.5.1). Afin de poursuivre des objectifs de politique sociale, les cantons doivent impérativement recourir aux instruments prévus (par exemple, l’art. 12 ou l’art. 29 al. 2 AIMP) ou justifier leurs mesures en démontrant qu’elles constituent des critères d’aptitude objectivement indispensables. Dans ce contexte, Schneider Heusi laisse entendre l’existence d’une « pomme de discorde » (Zankapfel) sur la définition de critères d’adjudication – tels que la « fiabilité du prix » ou la « prise en compte des niveaux de prix différenciés » – dont la conformité à l’AIMP reste douteuse45.
La décision de la Cour constitutionnelle jurassienne (CST 1/2023), qui a invalidé l’article 15 alinéa 3 LMP-JU portant sur ces mêmes critères, vient confirmer la position restrictive quant à l’introduction, par les cantons, de nouveaux critères d’adjudication en dehors du cadre strict de l’AIMP. La Cour précise d’ailleurs dans ses considérants (4.3.1) que « si l’art. 29 al. 1 AIMP 2019 dresse une liste exemplative des critères d’adjudication, cela ne signifie pas que les cantons peuvent librement en ajouter d’autres qui ne seraient pas en lien avec les caractéristiques intrinsèques de l’offre ou la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché dans les règles de l’art. » Dès lors, la jurisprudence – à l’image de l’arrêt CST 1/2023 précité – devra continuer de clarifier la validité de telles initiatives, sans quoi les cantons seront contraints d’explorer d’autres instruments. De Rossa Gisimundo met en garde contre l’absence d’un cadre légal précis, soulignant que sans celui-ci, les objectifs de durabilité risquent de rester lettre morte ou de dissimuler des mesures protectionnistes, comme en témoignent la révision tessinoise (LCPubb/TI) avec sa « clause d’exclusivité suisse » et l’interdiction de la sous-traitance46.
2. Vers une éventuelle évolution de l’AIMP 2019 ?
L’arrêt suggère qu’en cas de rigidité excessive de l’AIMP pour intégrer de manière satisfaisante les enjeux sociaux et environnementaux au niveau cantonal, il pourrait s’avérer nécessaire d’envisager une adaptation future de cet accord. Cette problématique rejoint le débat permanent entre l’impératif d’une harmonisation stricte et la nécessité d’une certaine flexibilité cantonale.
En confirmant la portée « minimale » et « étroitement limitée » de la marge de manœuvre cantonale pour les dispositions d’exécution, l’arrêt commenté souligne le caractère largement exhaustif du cadre posé par l’AIMP 2019. Cette rigueur, si elle est essentielle à l’harmonisation, pourrait à terme mettre en lumière les limites de l’accord actuel face à des enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux ou dont l’acuité s’est renforcée. Si les instruments prévus par l’AIMP 2019 (tels que les art. 12, 26, 27 ou 29) s’avèrent insuffisants ou trop contraignants pour permettre aux cantons de répondre de manière adéquate à ces défis dans le respect de leurs compétences résiduelles, la question d’une révision concertée de l’AIMP pourrait effectivement se poser. Un tel processus devrait alors soigneusement peser les bénéfices d’une harmonisation poussée face au besoin de flexibilité et d’innovation au niveau cantonal.
3. L’importance d’une application rigoureuse et justifiée
Les entités adjudicatrices devront dorénavant justifier, de manière objective, toute décision de limiter ou d’exclure la location de personnel pour un marché donné. L’arrêt met en lumière la responsabilité de ces acteurs quant à la motivation et à la proportionnalité de leurs décisions. De même, l’application rigoureuse des nouveaux instruments – qu’il s’agisse du dialogue prévu par l’art. 24 AIMP ou des contrats-cadres de l’art. 25 AIMP – nécessitera une attention particulière. La « nouvelle culture des marchés publics » orientée vers une durabilité accrue doit impérativement respecter les cadres légaux en vigueur. Schneider Heusi note que l’offre « économiquement la plus avantageuse » du précédent accord incluait déjà la qualité avant la révision47. La terminologie de l’AIMP 2019 a évolué vers « l’offre la plus avantageuse » (art. 41 AIMP), le Message type précisant que cela « montre que la course à l’excellence doit dorénavant avoir encore plus de poids que la concurrence par les prix »48.
Par ailleurs, plusieurs arrêts du Tribunal fédéral soulignent l’importance du contrôle de la conformité des lois cantonales au droit supérieur – qu’il soit intercantonal ou fédéral – illustrant ainsi la procédure de contrôle abstrait des normes49. Il apparaît essentiel que les cantons s’assurent que leurs législations demeurent en parfaite harmonie avec le cadre juridique supérieur.
Enfin, bien que n’étant pas au centre des arrêts commentés, l’art. 50 Cst. garantit l’autonomie communale dans les limites du droit cantonal et impose à la Confédération de prendre en compte les répercussions de ses actions sur les communes. Étant donné que de nombreux marchés publics relèvent de la compétence des entités communales, l’application harmonisée de l’AIMP entre cantons et communes représente un enjeu majeur du fédéralisme, nécessitant une articulation fine avec le degré d’autonomie reconnu aux communes en matière de passation de marchés.
En définitive, l’avenir des politiques sociales dans les marchés publics dépendra d’une application rigoureuse des instruments prévus par l’AIMP et, le cas échéant, d’une évolution future de ce cadre afin d’intégrer de manière optimale les enjeux sociaux et environnementaux. Les acteurs publics se doivent ainsi d’innover tout en respectant strictement les principes d’harmonisation et de légalité imposés par le droit supérieur, garantissant une approche durable et équitable des marchés publics.
F. Conclusions
L’arrêt 2C_587/2023 (et son pendant 2C_662/2023) confirme que la marge de manœuvre cantonale dans l’exécution de l’AIMP 2019 est strictement subordonnée à un « lien étroit » avec l’accord lui-même et au respect de ses objectifs d’harmonisation, conformément à l’article 48 alinéa 5 Cst. Ces décisions renforcent l’architecture harmonisée de l’AIMP en limitant les initiatives cantonales qui ne s’y rapporteraient pas de manière rigoureuse. Tout en reconnaissant une marge d’appréciation aux entités adjudicatrices pour adopter des mesures spécifiques justifiées, elles rappellent que la distinction entre objectifs propres aux marchés publics et ambitions de politique sociale doit être scrupuleusement entretenue. Le défi consiste ainsi à garantir que les objectifs de durabilité soient poursuivis de manière effective et non discriminatoire, sans dévier vers un protectionnisme déguisé. Par ailleurs, la jurisprudence récente [arrêt du TF 2C_661/2019 (Tessin) ; 2C_325/2023 (Vaud), CST 1/2023-(Jura)] corrobore cette approche en insistant sur la nécessité pour les réglementations cantonales de s’inscrire pleinement dans le cadre de l’AIMP, de respecter la législation fédérale et les traités internationaux et de justifier toute restriction à la concurrence ou à la liberté économique par des motifs impérieux étroitement liés à l’objet du marché.
Notes
- Voir sur l’ensemble de la question : Christian Dominicé, « Fédéralisme coopératif », in : RDS 88 (1969) II, p. 743-894 ; Ulrich Häfelin, « Der kooperative Föderalismus in der Schweiz », in : RDS 88 (1969) II, p. 549-741 ; Tobias Jaag, « Kooperativer Föderalismus – Verstärkte Zusammenarbeit im Bundesstaat », in : PJA 22 (2013) 5, p. 774-781. ↩
- Arrêt du TF 2C_456/2023 du 23 juillet 2024, consid. 4.2. ↩
- Rainer J. Schweizer, in : Ehrenzeller et al. (éd.), St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 4e éd. 2023, N. 10 ad art. 48 ; Waldmann/Schnyder Von Wartensee, in : Waldmann/Belser/Epiney (éd.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015, N. 2 et 10 ad art. 48 ; Giovanni Biaggini, BV Kommentar, 2e éd. 2017, N. 4 ad art. 48. ↩
- Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd., Berne 2022. ↩
- Christoph Jäger, « Öffentliches Beschaffungsrecht », in : Feller/ Müller (éd.), Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2021, N. 1. ↩
- Claudia Schneider Heusi, « Neues Vergaberecht in den Kantonen : Überblick und erste Bilanz », in : ZBl 124/2023, p. 515-537, spé. 516. ↩
- Message type AIMP, ch. 2.4, p. 19, et ch. 10, p. 103. ↩
- Ibid., p. 38 s. et 103. ↩
- Etienne Poltier, op. cit., N. 59. ↩
- Claudia Schneider Heusi, op. cit., p. 519. ↩
- Waldmann/Schnyder Von Wartensee, op. cit., N. 60 ad art. 48. ↩
- Eloi Jeannerat, in : Marteney/Dubey (éd.), Commentaire romand - Constitution fédérale, 2021 N. 48 ss ad art. 48. ↩
- Claudia Schneider Heusi, op. cit., p. 518 s.. ↩
- Nathalie Clausen, in : Trüeb (éd.), Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, N. 8 ss ad art. 63 AIMP. ↩
- Pour un commentaire de cette décision : Domenico Di Cicco, « La validité des critères de la fiabilité du prix et des différents niveaux de prix en droit cantonal » in : BR/DC 4/2024, p. 191-196. ↩
- Cf. notamment ATF 138 I 435, consid. 1.3.2 ; arrêt TF 2C_140/2021 du 17 novembre 2022, consid. 3.3. ↩
- Voir sur l’ensemble de la question : Vincent Martenet, in : Marteney/Dubey (éd.), Commentaire romand - Constitution fédérale, 2021, ad art. 49 ; Ruch/Errass, in : Ehrenzeller et al. (éd), St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 4e éd. 2023, ad art. 49. ↩
- Bernhard Waldmann, in : Waldmann/Belser/Epiney (éd.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015, N 1 ad art. 49. ↩
- Max Imboden, Bundesrecht bricht kantonales Recht, thèse Zurich, 1940 ; Bernhard Waldmann, « Bundesrecht bricht kantonales Recht », in : Rüssi/Hänni/Häggi Furrer (éd.), Staats- und Verwaltungsrecht auf vier Ebenen. Festschrift für Tobias Jaag, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 533 – 547. ↩
- Mario Marti, Changement de paradigme en droit des marchés publics, Mise en œuvre du nouveau droit des marchés publics du point de vue du secteur de la construction, Berne 2022 ; De Rossa/David, « La durabilité dans le nouveau droit des marchés publics : un changement de paradigme effectif ? », in : sui generis 2020, p. 441 ss. Cf. encore Hauser/Piskóty, Nachhaltige öffentliche Beschaffung, Vorgaben und Spielraum in der EU und im neuen schweizerischen Recht im Vergleich, Berne 2023. ↩
- La doctrine distingue généralement entre les critères d’aptitude et les critères d’adjudication, cf. Etienne Poltier, op. cit., N. 638 ss ; Olivier Rodondi, « Les critères d’aptitude et les critères d’adjudication dans les procédures de marchés publics », in : RDAF 2001 I p. 387 ss. ↩
- Christoph Jäger, « Ausschluss vom Verfahren – Gründe und der Rechtsschutz », in : Zufferey/Stöckli (éd.), Aktuelles Vergaberecht 2014/ Marchés publics 2014, Fribourg, 2014, p. 331 ss, spé. 339, N. 35. ↩
- Kurt Pärli, « Arbeitsrecht im öffentlichen Beschaffungswesen Inhalt und Auswirkungen der (revidierten) Bestimmungen im BöB und in der IVöB » in : Zufferey/Stöckli (éd.), Aktuelles Vergaberecht 2022 / Marchés publics 2022, Fribourg 2022, p. 147-179, spéc. 156, N 10. ↩
- Le non-respect d’une condition légale d’admission au marché ne constitue pas en principe un défaut mineur faisant apparaître une exclusion comme disproportionnée (ATF 143 I 177, consid. 2.2). Etienne Poltier, op. cit., N. 666. En matière de protection des travailleurs : Kurt Pärli, op. cit., N. 11 ; ég. sur l’ensemble de la question : Guerric Riedi, « Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs » in : Zufferey/Stöckli (éd.), Aktuelles Vergaberecht 2016 / Marchés publics 2016, Fribourg 2016, p. 303 ss. ↩
- Cette jurisprudence n’a pas pu être transposée sans autres considérations à l’affaire de l’arrêt commenté puisque, « dans ces causes, le Tribunal fédéral n’a pas eu à examiner si les réglementations cantonales litigieuses étaient conformes à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP 2019) », le canton du Tessin n’y ayant pas adhéré. ↩
- Kurt Pärli, op. cit., classifie et détaille le contenu de ces obligations en : « Arbeitsbedingungen » (conditions de travail lato sensu), « Arbeitsschutzbestimmungen » (droit public du travail), et égalité salariale. ↩
- Pour quelques cas d’application récents : Arrêt du Tribunal cantonal d’Argovie OGE 60/2018/7 du 3 juillet 2018 et du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne 810 19 185 du 20 novembre 2019. ↩
- Etienne Poltier, op. cit., N. 666. ↩
- Arrêt de la Cour Constitutionnelle du canton du Jura CST 1/2023 du 14 décembre 2023. ↩
- Etienne Poltier, op. cit., N. 554 ss ; Beat Joss, in : Trüeb (éd), Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, N. 27 ss ad art. 31 LMP/AIMP. ↩
- Federica De Rossa Gisimundo, « Nachhaltigkeit und Protektionismus im öffentlichen Beschaffungswesen. Der schmale Grat am Beispiel des neuen Tessiner Vergabegesetzes », in : Recht 3/2019, p. 166-179. ↩
- Arrêt TF 2C_325/2023 du 24 mai 2024 portant sur l’article 6 LMP-VD. ↩
- Arrêt ACST/28/2018 (Genève) du 12 décembre 2018. ↩
- Expertise de la COMCO du 21 octobre 2019 concernant l’admissibilité du principe du lieu d’exécution pour les conditions de travail dans le droit cantonal des marchés publics (622-00004), p. 9 et 11. ↩
- Ibid., p. 11 et 16. ↩
- Ibid., p. 11 et 16. ↩
- Ibid., p. 8. ↩
- Ibid., p. 9 et 11. ↩
- Ibid., p. 13, 14 et 17. ↩
- Ibid., p. 7. ↩
- Ibid., p. 5. ↩
- Ibid., p. 8. ↩
- Ibid., p. 8. ↩
- Kurt Pärli, op. cit., p. 160-161. ↩
- Claudia Schneider Heusi, op. cit., p. 522. ↩
- Federica De Rossa Gisimundo, op. cit., p. 179. ↩
- Claudia Schneider Heusi, op. cit., p. 536. ↩
- Message type AIMP, p. 21. ↩
- Not. arrêt du TF 1C_63/2023 du 17 octobre 2024. ↩