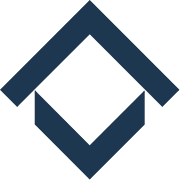Analyse de l’arrêt TF 2C_904/2022
25 mars 2025
Apparthôtels : quand le piège se referme sur les propriétaires
I. Objet des arrêts
Depuis longtemps, la doctrine met en garde contre différents dangers guettant les investisseurs désireux d’acquérir une part d’étage dans un apparthôtel1. Cette forme particulière de PPE présente en effet plusieurs caractéristiques auxquelles il convient d’être attentif. En effet, les apparthôtels cumulent les difficultés inhérentes à toutes les PPE, celles d’une exploitation hôtelière ainsi que celles issues du régime spécifique de droit public, découlant de la Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.41).
Les trois arrêts commentés ici portent sur la même affaire et le même apparthôtel grisonnais. Deux d’entre eux (TF 2C_904/2022 et 2C_981/2022) confirment le refus de lever l’obligation d’exploiter l’apparthôtel concerné en la forme hôtelière et le dernier (TF 2C_905/2022) rejette les arguments soulevés par certains propriétaires contre des nouveaux contrats qui les lient à l’exploitant.
Ensemble, ces arrêts referment le piège que peut constituer un apparthôtel pour l’acquéreur d’une part d’étage. Ils confirment largement les dangers mis en exergue dans la doctrine.
II. Résumé des arrêts
A. Les faits
En 1979, l’ancienne propriétaire du fonds sur lequel se trouvait déjà l’hôtel constitué en PPE a obtenu l’autorisation de vendre des appartements à des personnes à l’étranger. L’apparthôtel a alors été soumis à l’obligation d’exploitation hôtelière en vertu de l’ancienne Ordonnance du 10 novembre 1976 sur l’acquisition d’immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l’étranger (aOAITE).
En 2014, l’obligation d’exploitation hôtelière a été levée pour les appartements n’ayant jamais été exploité par l’hôtel ainsi que sur vingt autres, portant la part des appartements soumis à l’obligation de gestion à 65 %, soit la limite légale de l’art. 10 lit. b LFAIE.
Par décision du 17 octobre 2020, l’assemblée générale de la communauté des propriétaires d’étages a décidé de déposer une demande de levée de l’obligation d’exploitation hôtelière. Il a également été décidé de séparer l’hôtel et l’administration de la PPE. Une société détenue par l’ancien hôtelier a été choisie comme nouvel exploitant de l’hôtel à partir de l’exercice 2022.
L’Inspection du registre foncier et du registre commerce et le Tribunal administratif grisonnais ont successivement rejeté la levée de l’exploitation hôtelière. Ces instances ont par ailleurs validé les nouveaux contrats de bail et de gestion conclus entre la communauté des propriétaires d’étages et la société exploitante.
B. Le droit
[TF 2C_904/2022]
Obligation d’exploiter – Le Tribunal fédéral commence par exposer les principes régissant l’obligation d’exploiter en la forme hôtelière. Pour que l’usage d’un apparthôtel puisse être maintenu durablement, la législation impose à l’exploitant l’obligation d’exploiter et au propriétaire l’obligation de mettre son logement à disposition à cette fin (art. 10, 14 LFAIE ; 7 OAIE). Par ailleurs, le Tribunal fédéral souligne que le nouveau droit s’applique à la validité, au contenu, à la révocation et à la modification d’une charge, même si celle-ci se réfère à une autorisation accordée en vertu de l’ancien droit [consid. 3.1].
Révocation de l’obligation d’exploiter – L’obligation d’exploiter ne peut être révoquée que pour des raisons impérieuses, c’est-à-dire si un changement de circonstances rend l’exécution de la charge impossible ou inacceptable. La révocation de la charge est donc soumise à deux conditions : tout d’abord, les circonstances doivent avoir changé de manière significative et imprévisible ; en outre, le changement profond de la situation doit avoir eu un tel impact sur la situation de la personne concernée que le maintien et le respect de la charge seraient impossibles ou déraisonnables. En principe, l’acquéreur d’un logement dans un apparthôtel doit donc accepter le risque économique résultant de l’obligation de gestion. Il ne peut notamment pas s’attendre à réaliser un bénéfice en louant l’appartement [consid. 3.1].
En l’espèce, le Tribunal fédéral a repris à son compte l’argumentaire de l’instance inférieure, selon lequel seules des dépenses d’entretien, à hauteur d’un peu plus de CHF 8 millions avaient été investies dans l’hôtel entre les exercices 1996/97 et 2011/12, à l’exclusion de toute rénovation. Aucune réserve n’a été constituée en vue des rénovations futures. Aussi, ces montants étaient à mettre en regard des CHF 20 millions de bénéfices cumulés entre 1980 et 2011. Si un tel bénéfice est réalisé pendant 30 ans, il n’est pas possible de se prévaloir par la suite d’années déficitaires, lesquelles ne sont alors pas imprévisibles, pour invoquer le caractère déraisonnable de la poursuite de l’obligation d’exploitation [consid. 4.2 et 7.2].
De même, le Tribunal fédéral a aussi validé le raisonnement selon lequel, après avoir effectué les investissements nécessaires, estimée par les propriétaires d’étages à CHF 10 millions, il paraissait crédible que les appartements soumis à l’obligation de gestion puissent être exploités de manière rentable pour leurs propriétaires. Ainsi, le maintien de l’obligation d’exploitation ne s’avère pas non plus déraisonnable. A cet égard, le Tribunal fédéral souligne qu’il n’existe pas de seuil quantitatif à partir duquel les investissements nécessaires dans un bien immobilier soumis à une obligation d’exploitation seraient qualifiés d’imprévisibles. Il faut bien davantage évaluer s’il existe une perspective réaliste que les revenus de la location ne soient pas disproportionnés par rapport aux coûts du propriétaire. Tel est le cas en l’occurrence, puisque les derniers exercices montrent une importante réduction des pertes. Par ailleurs, les nouveaux contrats de bail et de gestion, signés entre les propriétaires et le nouvel exploitant, prévoient un bail annuel de CHF 120’000.-, une participation aux bénéfices de 20 % des propriétaires et la prise en charge par l’exploitant des frais annexes et de rénovation des appartements. Le Tribunal fédéral précise pour le surplus qu’il ne peut être exclu que le pronostic d’un redressement s’avère inexact et que la question de la levée de l’obligation se pose à nouveau ; il fait cependant le constat que les conditions ne sont pas réunies à l’heure actuelle [consid. 6.2 et 7.2].
Pour prouver le caractère déraisonnable de l’obligation d’exploitation, il appartient aux propriétaires d’étages de démontrer et de prouver que, même en supposant un redressement de l’hôtel dans les années à venir, les propriétaires des appartements soumis à l’obligation d’exploitation, en raison notamment d’un besoin d’investissement très élevé dans la structure générale du bâtiment, devraient s’attendre à des coûts si élevés qu’ils subiraient des pertes durables à long terme en louant leurs appartements [consid. 5.2 et 7.2].
Garantie de la propriété (art. 26 Cst.) – Rappel des principes [consid. 8.2]. En l’espèce, le Tribunal fédéral ne constate pas de violation de la garantie de propriété. La Haute Cour précise que l’existence d’une charge était connue des propriétaires au moment de l’achat et celle-ci a dû leur profiter s’agissant du prix d’achat. Le Tribunal fédéral relève que la décision contestée porte sur la levée de l’obligation d’exploiter et n’impose pas, en tant que telle, une obligation pour les propriétaires d’investir dans leurs appartements. Ainsi, il appartient aux propriétaires de décider si cela vaut la peine d’investir davantage dans les appartements qu’ils possèdent ou s’ils souhaitent les vendre [consid. 8.3].
[TF 2C_981/2022]
Les considérants ci-dessus se retrouvent en grande partie dans cet arrêt, avec de très faibles nuances.
Révocation de l’obligation d’exploiter – Pour le Tribunal fédéral, des erreurs de gestion passées, des différends entre les propriétaires d’étages, respectivement avec l’hôtelier, ont peut-être engendré une partie des pertes. Cela ne suffit pas pour exclure que l’exploitation puisse être rentable à l’avenir. Par ailleurs, le fait que la société exploitante a entrepris les travaux de rénovation dans les appartements – comme elle s’y était engagée – pourrait uniquement jouer un rôle, s’il était prévisible qu’elle ne pourra pas remplir ses obligations et que les coûts de rénovation des appartements, éventuellement par le biais de l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, seront finalement à la charge des propriétaires [consid. 7.2.3].
Egalité de traitement (art. 8 Cst.) – Se pose la question de savoir s’il existe une pratique illégale dans l’application de l’art. 14 al. 4 LFAIE et éventuellement un droit à l’égalité dans l’illégalité, puisque la levée de l’obligation d’exploitée a été acceptée pour de nombreux apparthôtels dans le canton des Grisons au cours des dernières décennies. Les propriétaires n’ont pas allégué ni prouvé que les conditions d’un droit à l’égalité dans l’illégalité existaient [consid. 8.2].
[TF 2C_905/2022]
Approbation des contrats de bail et de gestion – S’agissant de la nature juridique de ces contrats, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence, selon laquelle le contenu des contrats est de nature purement privée, mais ne correspond pas exclusivement à l’accord des volontés autonomes des parties. En effet, les contrats doivent être approuvés par une autorité administrative avant l’octroi de l’autorisation d’acquérir un apparthôtel soumis à l’obligation d’exploitation. En cas de modification ou de conclusion de nouveaux contrats d’exploitation, une validation de ceux-ci par l’autorité est nécessaire [consid. 3.2].
Pour le Tribunal fédéral, seul est pertinent pour la validation des contrats d’exploitation et de bail, le fait que ceux-ci ont été approuvés par l’assemblée des copropriétaires et qu’ils prévoient la poursuite de l’exploitation de l’hôtel et donc également la location des appartements soumis à l’obligation d’exploitation. La décision de la communauté des propriétaires de louer l’hôtel à une société d’exploitation distincte qui se chargera également de la gestion des appartements correspond à ces exigences. Par ailleurs, s’il l’on devait arriver à la conclusion qu’il est prévisible que l’établissement ne soit plus rentable à l’avenir, il conviendrait, dans un premier temps, de lever l’obligation d’exploiter et de refuser, dans un second temps, les nouveaux contrats [consid. 5.1].
Liberté économique (art. 27 Cst.) et liberté contractuelle (art. 19 CO) – Il n’existe pas non plus de violation de la liberté contractuelle ou de la liberté économique des propriétaires, puisque la décision en cause ne les force pas à conclure un contrat avec tiers ; c’est l’assemblée des propriétaires d’étages, par une prise de décision, qui en a décidé ainsi. Pour s’y opposer, c’est la voie de la contestation des décisions de l’assemblée (art. 75 en lien avec 712m CC) qui est pertinente [consid. 5.2].
III. Commentaire
a) Le constat d’un piège qui se referme
Le résultat auquel est parvenu le Tribunal fédéral dans les arrêts commentés ne surprend pas, puisqu’il semble avoir appliqué le droit ainsi que sa propre jurisprudence, très stricte en la matière. L’affaire traitée dans ces trois arrêts illustre la position juridique extrêmement fragile du propriétaire au sein d’un apparthôtel soumis à une obligation d’exploiter en la forme hôtelière, selon la LFAIE.
En effet, le propriétaire d’apparthôtel peut facilement se retrouver cerné par plusieurs feux. Plus que tout autre propriétaire d’étages, la loi organise sa mise en minorité au sein de la PPE, ce qui peut le contraindre à devoir accepter sur son immeuble, ce que peu de propriétaires ont à subir sur leur bien (cf. point b ci-après). Une sortie de cette situation est rendue très complexe par le régime de la LFAIE (cf. point c ci-après). Le recours aux droits fondamentaux ne sera d’aucun secours pour le propriétaire, même s’il ne se sent pas concerné la LFAIE, ayant son siège ou son domicile en Suisse (cf. point d ci-après). L’ensemble de ces aspects, fait de l’apparthôtel un actif risqué (cf. point e ci-après).
Alors que Wermelinger parle de l’apparthôtel, tel qu’il est conçu par la LFAIE, comme d’un « attrape-nigauds »2, les arrêts commentés décrivent l’une des façons (et non la seule3) dont le piège peut se refermer sur les propriétaires.
b) Propriétaire minoritaire et les conséquences
La position minoritaire du propriétaire est inhérente à l’institution de l’apparthôtel4. Le législateur a conçu cette dernière de manière à ce que la gestion reste pleinement en mains de l’hôtelier5. Ainsi, l’art. 10 lit. a LFAIE exige que l’hôtelier soit propriétaire de la majorité des quotes-parts de la PPE6. Cette règle a une influence importante le processus décisionnel au sein de la PPE.
Si le vote par tête, prévu par le droit dispositif, s’applique (art. 67 al. 2 par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC), l’hôtelier ne dispose pas d’une majorité acquise pour toutes les décisions, mais néanmoins d’un fort levier de blocage. En effet, les décisions les plus importantes au sein d’une PPE requièrent la double majorité des propriétaires et des quotes-parts (cf. p.ex. pour la modification du Règlement d’administration, art. 712g al. 3 CC, ou les travaux utiles sur les parties communes, art. 712a en lien avec 647d CC), voire, dans de plus rares cas l’unanimité (cf. p.ex. art. 712a en lien avec 647e CC)7.
Si le vote par quote-part a été inscrit dans le Règlement d’administration de la PPE, ce qui n’est pas rare dans le contexte des apparthôtels8, l’hôtelier est automatiquement majoritaire pour toutes les décisions.
A cet égard, il faut souligner que la place prééminente de l’hôtelier ne s’arrête pas, comme dans une PPE ordinaire dans laquelle un propriétaire possède une majorité, aux parties communes. En effet, le droit des propriétaires sur leur droit exclusif est limité9, en ce sens que l’hôtelier peut p.ex. imposer des travaux et des actes d’administration, y compris dans les appartements10.
Les arrêts traités dans le présent commentaire illustrent bien ces enjeux. Il ne ressort pas des arrêts commentés que le vote par quote-part a été adopté au sein de l’apparthôtel. Pour autant, certains propriétaires se sont retrouvés forcés de conclure des contrats de bail et de gestion11 pour déléguer l’exploitation à tiers alors qu’ils s’opposaient à la fois au principe de cette délégation et au choix du tiers. Ils estimaient que ce dernier se trouvait dans une position de conflit d’intérêts, la gestion de l’établissement restant en réalité aux mains des mêmes personnes qu’au cours de la précédente décennie, qui avait été marquée par des pertes financières et des conflits12. Il apparaît également que des travaux de rénovation sur les appartements promis par la nouvelle société exploitante, travaux auxquels certains propriétaires s’opposaient, étaient en cours de réalisation au moment de la sortie de l’arrêt du Tribunal fédéral13. C’est dire à quel point la conception du droit exclusif au sens de l’art. 712a CC, selon lequel le propriétaire d’une part d’étage a « le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment », est restreint en matière d’apparthôtel.
c) L’art. 14 al. 4 LFAIE comme un cas de clausula rebus sic stantibus en droit public ?
En matière contractuelle, le droit suisse est marqué par le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda), lequel est notamment nuancé par la théorie de l’imprévision (clausula rebus sic stantibus)14. Cette dernière permet d’adapter un contrat, lorsque certaines conditions strictes sont réunies, à savoir :
1) un changement important et imprévisible des circonstances depuis la conclusion du contrat ;
2) ce changement entraîne une disproportion grave entre la prestation et la contreprestation du contrat, de sorte que son maintien deviendrait abusif15.
Cette théorie est applicable de manière générale à tous les contrats de durée, étant précisé que certains cas d’applications ont été intégrés dans la loi de manière explicite (art. 373 al. 2 CO en matière de contrat d’entreprise ; art. 337 al. 1 CO en matière de contrat de travail ; art. 266g CO en matière de bail à loyer)16. Lorsque la théorie de l’imprévision est ainsi codifiée, on reconnaît parfois que la loi aménage le principe en tenant compte de la situation visée. Pour Weber, lors de l’application de l’art. 266g CO, la condition de la disproportion entre les prestations prévues dans le contrat d’origine n’a pas besoin d’être réunie, la question de la protection de la personnalité du locataire étant ici centrale17. Le débat peut alors exister de savoir si la disposition en question constitue une lex specialis ou si elle laisse de la place pour une application de la clausula rebus sic stantibus par ailleurs18.
A notre sens, le Conseil fédéral – et le Tribunal fédéral à sa suite – ont érigé l’art. 14 al. 4 LFAIE en un cas d’application de la théorie de l’imprévision, dans le cadre spécifique d’une charge de droit public19, alors que rien, dans le texte de la loi, ne les contraignait à aller dans ce sens.
En matière d’obligation d’exploiter un apparthôtel, l’art. 14 al. 4 LFAIE se borne à exiger, pour une levée de la charge, des « motifs impérieux ». A l’art. 11 al. 4 OFAIE, le Conseil fédéral a choisi de faire une interprétation exigeante de cette notion juridiquement indéterminée, en estimant qu’était exigée, « une modification des circonstances qui rend l’exécution des charges impossible ou insupportable pour l’acquéreur ». Poursuivant l’escalade de cette interprétation stricte20 et pour le moins inspirée de la théorie de l’imprévision, le Tribunal fédéral considère pour le surplus que la modification des circonstances doit être importante et imprévisible et qu’elle doit avoir eu un tel impact sur la situation de la personne concernée que le maintien et le respect de la charge seraient impossibles ou déraisonnables21.
Bien entendu, dans le contexte de la levée d’une charge de droit public, il n’est pas question d’une disproportion des prestations contractuelles22, mais davantage, à la manière de la remarque précitée de Weber concernant l’art. 266g CO23, de la situation personnelle de la personne concernée, à savoir du propriétaire d’un appartement24.
En raccrochant les conditions de la levée de l’obligation d’exploiter à celles exigées par la théorie de l’imprévision, le Tribunal fédéral les a rendues extrêmement strictes25. Dans le cas d’espèce, il retient ainsi logiquement que des pertes dues à un manque d’investissement ne sont pas imprévisibles et qu’une décennie de pertes ne rend pas la situation du propriétaire déraisonnable, après de longues années de profits26. Il précise qu’il appartient aux propriétaires d’étages de démontrer et de prouver que, même en supposant un redressement de l’hôtel dans les années à venir, ils devraient s’attendre à des coûts si élevés qu’ils subiraient des pertes durables à long terme en louant leurs appartements27. Une telle preuve semble si difficile à apporter qu’il vaut mieux considérer, au moment d’investir dans un apparthôtel soumis à l’obligation d’exploiter, que cette obligation est définitive.
Outre ces difficultés, il faut également souligner le flou entourant les conditions d’application de l’art. 14 al. 4 LFAIE. En substance, le Tribunal fédéral indique à ce stade que les pertes ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs impérieux au sens de l’art. 14 al. 4 LFAIE, qu’il n’existe pas de seuil à partir duquel les pertes remplissent cette condition, mais qu’il n’est pas exclu, si elles devaient se poursuivre, que cette condition soit remplie un jour28. A la lecture de la jurisprudence, il apparaît que la levée de l’obligation est admise, lorsque les contrats engendrent pour les propriétaires des pertes structurelles certaines29. Si l’exploitant a l’habileté de prévoir des contrats ne permettant pas un tel calcul30, comme c’est le cas en l’espèce, il lui est possible d’obtenir gain de cause31. L’on comprend alors la frustration d’un propriétaire contraint de subir des pertes à long terme, sans connaître la limite à partir de laquelle la situation juridique peut être modifiée en sa faveur. C’est le sentiment d’un piège qui se referme sur lui. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte des arrêts commentés, où les instances judiciaires ont accordé davantage de crédit aux projections financières de l’exploitant qu’à celles des propriétaires.
d) Les griefs de violation de la garantie de la propriété et de l’égalité de traitement balayés
Dans les arrêts commentés, le Tribunal fédéral a survolé sur les griefs relatifs à une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à une violation de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
S’agissant de la garantie de la propriété, il est manifeste que les griefs se recoupent au moins en partie avec ceux qu’il est possible de faire valoir en arguant d’une violation des art. 14 al. 4 LFAIE et 11 al. 4 OFAIE32. Dès lors que la LFAIE ne peut être soumise à un contrôle de constitutionnalité (art. 190 Cst.), il est peu surprenant que le grief ait échoué auprès du Tribunal fédéral. Cela nonobstant, il est toutefois regrettable que ce dernier n’ait pas examiné dans le détail les conditions de l’art. 36 Cst. pour qu’une atteinte à la garantie de la propriété puisse être considérée comme constitutionnelle. Au lieu de cela, la Haute Cour a renvoyé les propriétaires à leur connaissance de l’existence de l’obligation d’exploiter et à la liberté dont dispose chaque investisseur : « Es ist an der Beschwerdeführerin abzuwägen, ob sich für sie weitere Investitionen in die von ihr gehaltenen Appartements lohnen oder ob sie sich, abhängig von ihrer eigenen Rentabilitätsbeurteilung, allenfalls für eine Veräusserung entscheidet »33. A l’évidence, il serait possible de botter en touche pareillement pour toute violation de la garantie de propriété : il est toujours possible de vendre à perte, lorsque la valeur d’un bien a diminué fortement à la suite d’une atteinte au droit de propriété.
Pourtant, sous l’angle de la garantie de propriété, l’on peut à tout le moins s’interroger sur l’existence d’un intérêt public ainsi sur le critère de l’aptitude, dans le cadre de l’examen de proportionnalité (cf. art. 36 Cst.), en particulier lorsque le propriétaire a son domicile ou son siège en Suisse. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient un rattachement réel (et non personnel) pour l’obligation d’exploitation hôtelière, de sorte que cette charge issue de la LFAIE perdure éternellement et ce, même si l’immeuble n’est pas ou plus la propriété d’une personne à l’étranger34. Dès lors que la base légale sur laquelle repose cette restriction du droit de propriété, à savoir les art. 10 et 14 LFAIE et l’art. 7 OAIE, a pour seul but de s’assurer que le sol suisse profite aux personnes qui y résident35, un examen approfondi de l’existence d’un intérêt public, respectivement de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, aurait été nécessaire. En l’espèce, il ressort de l’arrêt cantonal de l’affaire commentée qu’au moins une société avec un siège en Suisse, propriétaire de nombreux appartements dans l’apparthôtel, a tenté en vain (au moins en première instance) de faire valoir qu’elle n’était pas concernée par la LFAIE36.
S’agissant du grief d’égalité de traitement, il ressort de l’arrêt du TF 2C_981/2022 que les propriétaires se plaignaient de ne pas être traités de la même manière que les autres propriétaires d’apparthôtels du canton, alors qu’il est connu que la levée de l’obligation d’exploiter a été admise pour un grand nombre d’entre eux37. Ils n’avaient toutefois ni allégué ni prouvé l’existence d’une pratique de l’autorité contraire au droit et, partant, d’un droit à l’égalité dans l’illégalité38.
A l’égard de ce grief, il pourrait être intéressant de se poser la question de l’égalité de traitement au sein d’un même apparthôtel. En l’occurrence, il apparaît dans les faits des arrêts commentés que la levée de l’obligation d’exploiter a été admise en 2014 pour 20% des quotes-parts, les appartements avec obligation d’exploiter en la forme hôtelière passant de 85% à 65%39, soit le seuil légal (art. 10 lit. b LFAIE). Or, la situation financière de l’exploitation était largement meilleure en 2014 qu’au moment du rejet de la levée de l’obligation d’exploitation traitée dans les arrêts commentés, intervenue en 202240. En conséquence, si les motifs impérieux pour la levée de l’obligation d’exploitation étaient réunis en 2014, ils devraient l’être a fortiori en 2022. Dans ces circonstances, l’on peut supposer que l’autorité accepte de lever l’obligation à des conditions allégées, lorsque le statut de l’établissement en tant qu’apparthôtel au sens de l’art. 10 LFAIE n’est pas remis en cause, soit en l’occurrence lorsqu’au moins 65% des quotes-parts restent affectés à l’exploitation hôtelière. C’est peut-être là que réside la vraie inégalité de traitement.
Si tel devait être le cas, les propriétaires demandant la levée de l’obligation avant que le seuil de 65% ne soit atteint l’obtiendraient facilement, alors que ceux qui en font la demande par la suite devraient réunir les conditions strictes de l’art. 14 al. 4 LFAIE. Il s’agirait d’une sorte de règle du « premier arrivé, premier servi » s’appliquant à la levée de l’obligation d’exploiter. De nombreuses questions s’ouvrent à cet égard : Si la levée ne pouvait avoir lieu que pour une partie des appartements pour lesquels la demande a été faite, quels seraient les critères de sélection ? Au sein d’une même PPE, faudrait-il alors privilégier la levée de l’obligation d’exploiter des propriétaires ayant leur domicile en Suisse, compte tenu du but de la LFAIE ? Faudrait-il également tenir compte du fait que certains propriétaires ont effectivement connu de nombreuses années de bénéfices alors que des acquéreurs plus récents n’ont connu que des pertes ? Puisque la demande de levée de l’obligation suppose une décision de l’assemblée des copropriétaires, est-il acceptable que le choix des appartements concernés revienne à l’hôtelier si celui-ci se trouve en position majoritaire dans la PPE ? Ces questions restent malheureusement ouvertes à ce jour.
e) L’apparthôtel comme actif risqué
L’acquéreur d’un apparthôtel peut avoir le sentiment d’investir dans l’un des actifs les plus sûrs de la planète : l’immobilier suisse. Il peut croire au surplus que sa qualité de propriétaire lui confère d’importants pouvoirs. Ce qui précède doit le convaincre de revoir sa copie.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral, le risque économique est supporté par les propriétaires d’apparthôtel41. Ce risque n’est pas de même nature que le risque d’exploitation que supporte toute entreprise, laquelle peut établir une stratégie visant à la création de valeur. Il est également bien différent de celui du propriétaire foncier habituel, qui dispose, dans les limites de loi, d’une grande liberté pour tirer profit de son bien (usage en propre, location, rénovation, etc.). Cela est également valable pour le propriétaire d’étages, au moins sur sa partie privative. A l’inverse, l’acquéreur d’un apparthôtel a une posture passive et son risque est plus proche de celui supporté par l’actionnaire particulier, en l’occurrence de l’actionnaire d’une entreprise active dans l’hôtellerie.
Comme le petit actionnaire, il se trouve forcément en minorité dans la prise de décision (cf. le point a ci-dessus). Comme le petit actionnaire, son pouvoir sur l’exploitation hôtelière elle-même est nul. Comme le petit actionnaire, ce n’est pas lui qui décide qui dirigera l’exploitation et comment. Comme le petit actionnaire, ce n’est pas lui qui décide si son appartement est loué et à qui ou même si son appartement est rénové et comment. Comme le petit actionnaire, il peut tout au plus faire usage de son droit de vote et espérer dividendes et plus-value, si l’hôtel est rentable. Et si tout cela ne se passe pas comme prévu, il aura pour seul choix, comme le petit actionnaire, de vendre en essuyant des pertes ou de réinvestir dans son bien (« buy the dip » dirait-on en finance), mais selon un plan qui n’aura pas été conçu par lui.
A bon entendeur : l’apparthôtel devrait être considéré par l’investisseur comme un actif risqué42 et non comme une valeur défensive, comme peut l’être l’immobilier suisse en général. Un tel avertissement s’adresse en premier lieu à l’investisseur suisse, qui peut ignorer que la LFAIE puisse avoir une quelconque portée sur sa situation, alors que l’interprétation de cette loi par les autorités (cf. point b ci-dessus) engendre pour lui des atteintes importantes à son droit de propriété.
Cf. plus récemment : Albisetti Simone/Carri Andrea/Macri Francesco, L’apparthotel : il mirabile monstrum della LAFE e i suoi riverberi nella LASec, in : RTiD I 2022, p. 321 ss ; Wermelinger Amédéo, La LFAIE comme attrape-nigauds pour la PPE, in : Bohnet/Carron/Wermelinger (édit.), PPE 2023, 5e Séminaire sur la PPE, Neuchâtel 2023 (cité : Wermelinger LFAIE), p. 31 ss. Il est renvoyé à cette dernière contribution tant pour la perspective historique (p. 37 ss) que pour approfondir le sujet (p. 46 ss), avec une large liste de dangers pour les propriétaires d’étages lesquels ne seront pas tous évoqués dans ce commentaire.
Notes
- Cf. déjà dans ce sens : Lüthi Gian Gaudenz, Anwendungsprobleme in der Bundesgesetzgebung über den Erwerb von Grundstücken im Ausland, thèse, Zurich 1987, p. 173 ss ; Ramel Éric, Le régime des apparthôtels dans la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeuble par des personnes à l’étranger – LFAIE, thèse, Lausanne 1990, p. 129 ss. ↩
- Cf. le titre de la contribution précitée, Wermelinger LFAIE. ↩
- L’adoption forcée des contrats qui lient les propriétaires à l’hôtelier, avec de nouvelles conditions défavorables aux propriétaires, en est une autre : cf. p.ex. ATF 130 II 290. ↩
- Cf. dans ce sens : Bodevin Valérie, Les « hôtels » en droit public de la construction, Lex Weber – Lex Koller – LAT, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2021, N 390. ↩
- FF 1981 III 553, 597 : « La séparation de la propriété doit permettre que la communauté des propriétaires par étages n’exerce aucune influence sur l’exploitation hôtelière, ce qui ne manquerait pas de favoriser les opérations tendant à éluder la loi ». ↩
- Bodevin, N 389. ↩
- Wermelinger Amédéo, art. 712g CC, N 30 ss ; art. 712m CC, N 39 ss, in : La propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 4e éd., Rothenburg 2021. ↩
- Selon Wermelinger LFAIE, N 29-30, ce cas de figure n’est pas rare en pratique. ↩
- Wermelinger Commentaire PPE, Terminologie, N 19. ↩
- Bodevin, N 390. ↩
- Le fait de forcer les propriétaires à la conclusion de contrats qui leur déplaisent est pleinement assumé par le Tribunal fédéral, cf. ATF 130 II 290, consid. 2.3 : « Da die Wohnungseigentümer in der Regel kaum freiwillig einer für sie nachteiligen Vertragsänderung zustimmen werden, ergibt sich diese Lösung praktisch nur, wenn sie öffentlichrechtlich durchgesetzt werden kann ». ↩
- TF 2C_905/2022, consid. 5.2. ↩
- TF 2C_981/2022, consid. 7.2.3 [argument irrecevable]. ↩
- Cf. en détails sur ces notions : Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, Le droit des obligations, 7e éd., Genève/Zurich 2024, N 1008 ss ; 1050 ss. ↩
- ATF 135 III 1, consid. 2.4 ; TF 4A_158/2024, consid. 8.1. ↩
- ATF 135 III 1, consid. 2.4. ↩
- Weber Roger, art. 266g CO, N 1, in : Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6e éd., Bâle 2015. ↩
- Débat doctrinal ouvert concernant l’art. 266g CO, cf. p.ex. Higi Peter, art. 266g CO, N 42, in : Zürcher Kommentar, Die Miete, Art. 266-268b OR, 5e éd., Zurich 2020 [lex specialis] ; Contra : Bohnet François, Bail à loyer pour locaux commerciaux et Ordonnance 2 COVID-19, in : Cahiers du bail 2/2020, p. 26 [co-existence des deux régimes]. ↩
- Pour une comparaison également pertinente avec le cas de rigueur prévu à l’art. 8 al. 3 LFAIE, cf. Lüthi, p. 181 ss. ↩
- Cf. critique à cet égard : Lüthi, p. 186 ss. ↩
- TF 2C_904/2022, consid. 3.1. ↩
- Il pourrait néanmoins être défendu que la disproportion se situe au niveau des contrats qui lient les propriétaires et l’exploitant hôtelier. Cf. dans ce sens : ATF 132 II 171, consid. 2.2, dans lequel l’obligation d’exploiter est levée alors que le Tribunal fédéral constate que, « [d]araus ergibt sich für die Wohnungseigentümer insbesondere ein klares Missverhältnis zwischen markant geringeren, selbst so noch unsicheren Einnahmen und zumindest dreimal so hohen Kosten für die Vermietungszeit ». ↩
- BSK-Weber, art. 266g CO, N 1. ↩
- Cf. ég. Tercier/Pichonnaz Pascal, N 1055, pour lesquels la seconde condition d’application de la théorie de l’imprévision est une « charge excessive pour le débiteur », la disproportion des prestations étant le facteur à l’origine de celle-ci. ↩
- Pour Ramel, p 159, « la libération de l’obligation de mise à disposition est rendue quasiment illusoire » par cette réglementation, ajoutant pour le surplus que la suppression de la charge « déjà difficile à obtenir en elle-même, ne supprime pas le contenu du règlement et de l’acte de constitution de la propriété par étages ». ↩
- TF 2C_904/2022, consid. 4.2 et 7.2. ↩
- TF 2C_904/2022, consid. 5.2 et 7.2. ↩
- TF 2C_904/2022, consid. 7.2 in fine : « Es ist zwar nicht völlig auszuschliessen, dass sich die Prognose eines Turnarounds, auf welcher der Entscheid der Vorinstanz unter anderem beruht, als unzutreffend herausstellt und sich dann erneut die Frage stellt, ob den Eigentümern der bewirtschaftungspflichten Wohnungen die Aufrechterhaltung der Auflage weiter zuzumuten ist ; zurzeit sind indessen die Voraussetzungen für deren Aufhebung nicht erfüllt ». ↩
- Cf. ATF 132 II 171, consid. 2.2, dans lequel la part des revenus nets tirés des locations revenant aux propriétaires passait de 43% à 16%, montant qui ne parvenait manifestement pas à couvrir les frais d’exploitation et de rénovations dus chaque année. ↩
- En l’espèce, l’exploitant a notamment pris en charge la rénovation des appartements (TF 2C_704/2022, consid. 6.2 et 7.2), ce qui n’était pas le cas dans l’affaire précitée, dans laquelle l’obligation d’exploiter a pu être levée (ATF 132 II 171, consid. 2.2). ↩
- Le flou de ces conditions n’est d’ailleurs pas non plus totalement à l’avantage de l’hôtelier qui souhaite adapter les contrats qui le lie aux propriétaires. En effet, celui-ci fait alors face à un « dilemme », puisque proposer une modification des contrats peut entraîner une levée de l’obligation d’exploiter (et donc la perte potentielle de son outil de travail) sans indemnisation en sa faveur. Cf. en ce sens : Lardi Mauro, Apparthôtel – Widerruf der Bewirtschaftungspflicht wegen Unzumutbarkeit, p. 50 ss, in : Lardi/Boldi (édit.), Immobilienrecht, Handbuch zu rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten, Zurich/Saint-Gall 2017. ↩
- Cf. explicitement : TF 2C_981/2022, consid. 7.3 in fine. ↩
- TF 2C_904/2022, consid. 8.3. ↩
- Cf. en détails sur cette question Wermelinger LFAIE, N 35 ss, 65 ss et 80-81 pour lequel les art. 10 LFAIE et 7 al. 2 OAIE constituent des violations de la garantie de propriété, avec pour conséquence que le Tribunal fédéral devrait donner mandat au législateur de modifier la loi pour les personnes assujetties à la LFAIE et qu’il modifie sa jurisprudence à l’égard de celles qui ne le sont pas. Pour Ramel, p. 143, également, en cas de vente à une personne en Suisse, la charge de droit public devrait tomber, l’acquéreur pouvant néanmoins rester tenu de mettre à disposition son appartement en vertu du règlement de la PPE. ↩
- Cf. explicitement : ATF 147 II 281, consid. 4 ; également en détails : Wermelinger LFAIE, N 6 ss. ↩
- Arrêt du Tribunal administratif des Grisons, U 22 13 et U 22 14, point 13.1 des faits. ↩
- La chute du nombre d’apparthôtels est un phénomène connu et documenté, cf. Bodevin, N 396 et les références citées. ↩
- TF 2C_981/2022, consid. 8.2. ↩
- TF 2C_904/2022, consid. A.a. in fine. ↩
- TF 2C_904/2022, consid. 4.2 : il semble que les premières pertes financières sont apparues en 2012 et se sont poursuivies au moins jusqu’en 2021. ↩
- TF 2C_904/2022, consid. 3.1. ↩
- Lüthi, p. 179 : « Aus den weiter oben namhaft gemachten Gründen wird [der Eigentümer] sich aber in seinen Ertragserwartungen praktisch ausnahmlos enttäuscht sehen ». ↩