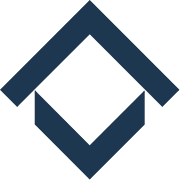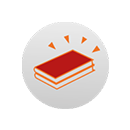Analyse de l’arrêt TF 5A_85/2024
28 janvier 2025
Servitudes de restriction des droits à bâtir – quelle place donner au droit public de la construction et de l’aménagement du territoire ?
I. Objet de l’arrêt
L’arrêt donne une interprétation de la notion d’un étage qui figure dans le libellé de la servitude litigieuse inscrit au registre foncier sous le mot-clé « Baubeschränkung (eingeschossig)1 ». Pour y parvenir, le Tribunal fédéral traite de la place du droit public de la construction et de l’aménagement du territoire dans le contexte des servitudes de restriction des droits à bâtir. La notion d’« étage » doit être interprétée à l’aune de l’usage général de ce terme au moment de la constitution de la servitude, sous réserve d’un usage local particulier. Le recours est admis.
II. Résumé de l’arrêt
A. Les faits
Une servitude foncière est constituée contractuellement le 27 octobre 1971. Les parties au contrat constitutif de servitude ne sont pas les mêmes que les propriétaires actuels. Le libellée de la servitude est inscrit au registre foncier sous le mot-clé « Baubeschränkung (eingeschossig) ».
La propriétaire du fonds servant prévoit d’y construire une maison familiale double de trois étages. Le permis de construire a été délivré et les autorités administratives concernées ont renvoyé au juge civil pour les griefs de droit civil.
Il ressort de la décision de première instance que le sous-sol dépasse de 2.7 mètres le terrain naturel, que les combles ont une surface de 147.03 m2 qui représente près de 70% du rez-de-chaussée dont la surface est de 217.96 m2.
Par action du 6 janvier 2022 devant le Tribunal cantonal de Nidwald (« Kantonsgericht Nidwalden »), la recourante conclut à ce qu’il soit interdit à l’intimée, sous peine de sanctions pénales, de construire sur le fonds servant la maison familiale double de trois étages déjà autorisée par l’autorité administrative compétente. Le grief invoqué est que le but de la servitude n’est pas respecté pour la nouvelle construction, compte tenu de ses dimensions. L’intimée fait valoir que la construction projetée ne comporte qu’un seul étage complet au sens du droit public de la construction. En outre, selon elle, il s’agit d’une servitude de vue qui doit être comprise comme une limitation de la hauteur de la construction. La recourante percevrait uniquement l’étage supérieur de la construction prévue car elle se situe sur la pente au-dessus du fonds à bâtir.
Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal cantonal de Nidwald admet l’action et interdit la construction prévue.
Par jugement du 14 septembre 2023, l’« Obergericht des Kantonsgerichts Obwalden » [sic]2 admet l’appel contre le jugement du 21 décembre 2022.
Par un recours en matière civile du 5 février 2024 auprès du Tribunal fédéral, la recourante demande l’annulation du jugement de l’« Obergericht des Kantonsgerichts Obwalden » [sic] et la confirmation du jugement du Tribunal cantonal de Nidwald, éventuellement le renvoi de la cause pour nouvelle décision.
B. Le droit
Le Tribunal fédéral commence par un rappel des principes en matière d’interprétation d’une servitude à la lumière des art. 738 CC et 18 al. 1 CO (consid. 2).
Une servitude limitant les constructions sur le fonds servant à un étage ne constitue pas uniquement une limitation de la hauteur, comme les servitudes de vue, lesquelles sont le plus souvent libellées comme telles. Elle vise également d’autres buts, tels que la limitation de la surface bâtie, de la densité et donc le maintien du caractère paysager avec des chalets et la qualité d’habitation qui en découle (consid. 4.3-4.4).
La description de la servitude au registre foncier n’est claire qu’en apparence. Le mot « étage » peut avoir plusieurs significations. Selon l’usage courant, il faut entendre par « étage » la partie du bâtiment qui comprend toutes les pièces individuelles situées au même niveau. Les termes de « sous-sol », de « rez-de-chaussée » et de « grenier » décrivent la verticalité des étages et font également partie du langage courant. S’agissant de la notion d’« étage complet » avancée par l’intimée, il ne s’agit pas d’une notion d’usage courant. Cette notion ne figure en outre pas dans l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) qui se limite à définir la notion d’étage dans son annexe 1. Cette notion pourrait tout au plus revêtir une importance subsidiaire dans l’interprétation de la servitude (consid. 5.3).
L’« Obergericht des Kantonsgerichts Obwalden » [sic] s’est appuyé à tort sur le droit cantonal en matière de construction actuellement en vigueur et de manière contraignante. En outre, la servitude représente un instrument qui permet aux propriétaires fonciers d’imposer, sur une base de droit privé, des restrictions à la construction qui n’ont du sens que dans la mesure où elles sont plus restrictives que le droit public. C’est précisément lorsque le contenu de la servitude restreint les possibilités offertes par le droit public que le but de la servitude se réalise. Ainsi, ni un plan d’aménagement, ni l’évolution générale du droit public de la construction et de l’aménagement du territoire, en particulier l’intérêt public à une densification des constructions, ne peuvent rendre sans effet des restrictions de droit privé à la construction ou limiter le contenu d’une servitude existante (consid. 5.4).
La notion d’« étage » doit être interprétée à l’aune de l’usage général de ce terme au moment de la constitution de la servitude, sous réserve d’un usage local particulier. Le Tribunal fédéral retient qu’il faut en premier lieu se baser sur l’impression visuelle de la construction à réaliser. Le règlement local de construction en vigueur au moment de la constitution de la servitude peut constituer une aide en cas de doute sur la délimitation à opérer. La perception visuelle d’un sous-sol n’est pas forcément celle d’un étage du seul fait qu’il dépasse du sol sur une petite partie. En l’espèce, toutefois, le sous-sol de la construction projetée émerge entièrement de la pente, c’est-à-dire à partir du niveau du sol, et la façade est entièrement pourvue de fenêtres panoramiques sur toute la hauteur. Ce sous-sol est conçu comme un véritable étage d’habitation, puisqu’il comprend une chambre à coucher, une salle de bain et un bureau. Il en est d’ailleurs de même des combles qui représentent près de 70 % de la surface de l’étage principal et sont aussi dotés de fenêtres panoramiques. Au total, le bâtiment projeté présente de manière évidente trois étages, tous destinés à l’habitation, de sorte que le projet est incompatible avec la servitude inscrite au registre foncier. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se référer à titre subsidiaire à l’ancienne ordonnance communale sur les constructions (consid. 5.4).
En conclusion, le recours est admis (consid. 6).
III. Analyse
Les servitudes de restriction des droits à bâtir limitent la possibilité de construire que ce soit dans son ampleur (hauteur, largeur ou profondeur) ou dans son caractère économique et social, voire esthétique3. Elles poursuivent des buts très variés comme la limitation du volume des constructions, la garantie de l’ensoleillement, le dégagement de la vue, etc.4. Elles donnent donc très souvent lieu à des procédures judiciaires quant à leur interprétation. A cela s’ajoutent de grands enjeux financiers qui découlent d’un projet de construction.
Les faits de l’arrêt en question sont une bonne illustration de la place des servitudes de restriction des droits à bâtir dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Dans la plupart des cantons, la procédure administrative relative à l’autorisation de construire est séparée de la procédure civile de manière absolue5. Les motifs de l’opposition au projet de construction ne peuvent porter que sur la violation du droit public. La délivrance du permis de construire peut avoir pour conséquence d’autoriser une construction contraire à une servitude foncière6. En matière de servitudes foncières, le juge civil dispose d’une marge d’appréciation, même une fois l’autorisation de construire entrée en force7. Le titulaire de la servitude pourra saisir le juge civil, qu’il ait fait opposition ou non au projet de construction8. Il s’agit en effet de deux procédures indépendantes pouvant dès lors aboutir à des résultats différents. Si l’interprétation du juge civil de la servitude de restriction du droit à bâtir, conformément à l’art. 738 CC, mène à la conclusion qu’elle interdit la construction litigieuse, le juge tranchera en conséquence9.
L’interprétation d’une servitude foncière est du ressort du juge civil10. Cette compétence a encore été relevée par le Tribunal fédéral dans le cadre de l’interprétation de servitudes de restriction des droits à bâtir11. Le droit public constitue seulement un critère d’interprétation de la terminologie utilisée dans un contrat de droit privé12. Le rôle subsidiaire du droit public en matière d’interprétation des servitudes foncières est renforcé par le présent arrêt, le Tribunal fédéral affirmant que l’« Obergericht des Kantonsgerichts Obwalden » [sic] s’est appuyé à tort sur le droit cantonal en matière de construction de manière contraignante. Le droit public n’est donc pas contraignant en matière d’interprétation des servitudes.
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le droit public de la construction et de l’aménagement du territoire, tout comme des actes de planification, ne sauraient avoir pour conséquence de limiter le contenu de la servitude existante ou de rendre celle-ci sans effet. Il ressort de ce constat un élément essentiel pour déterminer si une servitude foncière est opposable au droit public : un critère temporel. Le Tribunal fédéral mentionne expressément la servitude existante. Le contenu de la servitude foncière (conventionnelle) est fixé par un contrat qui répond aux règles du Code des obligations dont la portée est générale13. Conformément à l’art. 19 al. 1 CO, l’objet du contrat peut être librement déterminé dans les limites de la loi14. Le contenu du contrat constitutif de servitude doit être licite15, soit tenir compte de l’ordre juridique en vigueur. Seules sont opposables au droit public de la construction et de l’aménagement du territoire les servitudes qui leur sont postérieures et donc, en d’autres termes, existantes. S’agissant du moment déterminant, le Tribunal fédéral se réfère à l’adoption du droit public de la construction16, et ce alors que, dans un autre arrêt, il se réfère à l’entrée en vigueur d’un nouveau plan de zone17. Un autre arrêt encore reste vague à ce propos18. Pour se fonder sur un critère objectif et en respect du principe de la légalité, l’entrée en vigueur devrait être le moment clé retenu, étant précisé qu’il faut encore que le contenu de la servitude contrevienne aux faits pour lesquels la loi ou la mesure de planification s’applique19.
Dans l’arrêt qui fait l’objet du présent commentaire, le Tribunal fédéral mentionne expressément l’intérêt public à la densification des constructions. Orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti est, depuis la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire entrée en vigueur en 2014, un but de droit public prioritaire20. Néanmoins, les servitudes de restriction des droits à bâtir peuvent représenter des obstacles dans ce contexte. Nombreux sont les cantons qui ont adopté des bases légales en vue de lever les servitudes opposables au droit public qui font obstacle à la densification21. L’avenir de ces servitudes dépend alors de la protection conférée par la garantie de la propriété ancrée à l’art. 26 Cst. et des restrictions prévues à l’art. 36 Cst.22.
La voie civile offre peu de moyens en vue de la radiation d’une servitude de restriction du droit à bâtir face à un permis de construire. Les modes d’extinction, en général, sont les suivants : l’expropriation et les cas analogues, l’adjudication dans les enchères forcées, le jugement, la renonciation à la servitude, la perte totale du fonds dominant ou du fonds servant, l’impossibilité de l’exercice, la déréliction du fonds dominant ainsi que l’expiration du temps pour lequel la servitude a été constituée, en vertu d’un acte juridique ou en vertu de la seule volonté du propriétaire du fonds dominant23. S’agissant spécifiquement des servitudes de restriction des droits à bâtir face à un permis de construire, l’expropriation, le jugement et l’extinction en vertu d’un acte juridique, sont ceux qui pourraient entrer en ligne de compte. Néanmoins, bien que l’expropriation de la servitude soit un mode d’extinction reconnu par la doctrine civile, elle est régie par le droit public. L’extinction en vertu d’un acte juridique est possible mais, vu le contexte litigieux, de nombreuses négociations à cet effet seront certainement nécessaires. Par jugement, il faut entendre l’action en libération judiciaire de l’art. 736 CC. Il est intéressant d’analyser la thématique sous cet angle.
Le Tribunal fédéral a rendu un deuxième arrêt à la même date que l’arrêt commenté24, également en matière de servitudes de restriction des droits à bâtir, dans le contexte de l’art. 736 CC. Le Tribunal fédéral commence par analyser le litige sous l’angle du premier alinéa de la disposition (consid. 2 à 4). Il arrive à la conclusion que la recourante n’a pas démontré que la servitude a perdu tout intérêt pour le fonds dominant (consid. 4.9). Cet arrêt peut être comparé avec un arrêt plus ancien du Tribunal fédéral dans lequel des divisions parcellaires ont également eu lieu25. Elles ont eu pour conséquence des reports successifs de servitudes de restriction des droits à bâtir. Des bâtiments ont été érigés entre les fonds concernés par la servitude de restriction du droit à bâtir litigieuse. S’agissant de préserver le dégagement et la vue, conformément à la servitude, le fonds servant est peu, voire pas du tout, visible depuis le fonds de l’ayant droit, de sorte que la servitude ne fait plus sens. Même si son but est également de garantir la tranquillité en maintenant un voisinage peu construit, le développement du quartier ne suffit pas en soi à démontrer l’intérêt au maintien de la servitude (in abstracto). Au vu de son but, la servitude a perdu son utilité puisque, compte tenu du développement déjà intervenu du quartier, il ne peut plus être atteint. La servitude ne fait dès lors pas obstacle à la construction26.
Le Tribunal fédéral examine ensuite la problématique au vu de l’art. 736 al. 2 CC (consid. 5). Selon le Tribunal fédéral, l’affirmation de la recourante quant à l’existence d’une augmentation déraisonnable de la charge dans la mesure où le fonds servant se situait en zone agricole lors de la constitution de la servitude alors qu’il est actuellement situé en zone à bâtir est vaine. Son raisonnement est que la servitude de restriction du droit à bâtir n’a de sens que si elle restreint les possibilités de construction offertes par le droit public. Elle prend alors justement tout son sens. Le Tribunal fédéral affirme exactement, comme dans le présent arrêt commenté, que le droit public de la construction et de l’aménagement du territoire, tout comme des actes de planification, ne sauraient avoir pour conséquence de limiter le contenu de la servitude existante ou de le rendre sans effet. Il ajoute que des modifications du droit public de la construction et de l’aménagement du territoire ne sauraient à elles seules justifier la radiation de la servitude au sens de l’art. 736 al. 2 CC27. Il conclut au rejet du recours (consid. 6).
Ce raisonnement n’est pas nouveau. Afin de déterminer si une servitude foncière s’éteint en vertu de l’art. 736 al. 2 CC, le juge civil procède à une pesée des intérêts du propriétaire du fonds servant et du propriétaire du fonds dominant28. Dans le cadre d’un projet de construction mêlé à une servitude de restriction du droit à bâtir, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral une augmentation des intérêts de part et d’autre, qui aboutit à un « match nul »29. D’un côté, le propriétaire désireux de construire voit son intérêt à la radiation de la servitude grandir, d’autant plus qu’au vu de l’évolution du droit public de l’aménagement du territoire, il pourrait être amené à pouvoir bâtir plus densément son bien-fonds qu’auparavant. De l’autre côté, la servitude prend alors tout son sens puisqu’elle vise à empêcher la construction. La balance reste équilibrée entre l’intérêt au maintien et à la suppression de la servitude. Sa radiation n’est dès lors pas ordonnée, faute d’une disproportion entre l’utilité et la charge relatives à la servitude.
En conclusion, la servitude de restriction du droit à bâtir ne saurait être négligée dans le cadre d’un projet de construire car l’évolution du droit public de la construction et de l’aménagement du territoire ne suffit en principe pas pour justifier sa radiation.
Notes
- Dans une traduction libre : Restriction de construire (un étage). ↩
- Il s’agit certainement de l’Obergericht des Kantons Nidwalden. ↩
- Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, § 458. ↩
- TF 5A_637/2019 du 27.04.2022, consid. 3.4 (préserver l’image du lotissement avec ses toitures à deux pans) ; TF 5A_692/2021 du 25.04.2022, consid. 5.3.4 (garantir l’éclairage, la vue et l’ensoleillement) ; TF 5A_162/2021 du 09.09.2021, consid. 5.2 (préserver la vue et la tranquillité) ; TF 5A_340/2013 du 27.08.2013, consid. 4.3.1.2 et 4.3.2 ; ATF 109 II 412, consid. 3. ↩
- P. ex. le canton de Genève : Bellanger François, La déclaration d’utilité publique à Genève, in : Tanquerel Thierry/Bellanger François (édit.), La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 61 ss, p. 69 ; le canton de Lucerne : Schmid Jörg, Dienstbarkeiten und das Bauen – von praktisch wichtigen Schnittstellen, in : Schweizerische Baurechtstagung/Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2015, p. 91 ss, p. 102, et pour d’autres exemples p. 103 ; Vallati Sacha, Dienstbarkeiten und Bauvorhaben – Analyse und Lösung von Konflikten zwischen Bauherren und dienstbarkeitsberechtigten oder -belasteten Dritten, thèse, Zurich/Bâle/Genève 2021, N 70. ↩
- Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, § 557. ↩
- TF 5A_637/2019 du 27.04.2022, consid. 2.4 ; TF 5A_663/2020, 5A_664/2020 du 02.02.2021, consid. 3.5.2.1 ; TF 1C_246/2015 du 04.03.2016, consid. 2.4. ↩
- TF 5A_663/2020, 5A_664/2020 du 02.02.2021, consid. 3.5.2.1. ↩
- Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, § 564 ss. ↩
- Pour un développement : Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, § 573 ss. ↩
- TF 1C_413/2019 du 24.03.2020, consid. 7.1 ; TF 1C_531/2018 du 29.07.2019, consid. 7.1 ; TF 1C_434/2015 du 08.04.2016, consid. 3.3 ; TF 5A_599/2013 du 14.04.2014, consid. 4.4 ; TF 1C_273/2011 du 17.10.2011, consid. 3.3. ↩
- TF 5A_599/2013 du 14.04.2014, consid. 4.4 ; TF 5C.240/2004 du 21.01.2005, consid. 4 : le Tribunal fédéral a considéré qu’une servitude peut être interprétée selon le règlement local sur les constructions pour définir en l’occurrence la notion de « bâtiments à deux étages » ; à ce sujet également ATF 99 II 152, consid. 3. ↩
- Art. 7 CC ; Foëx Bénédict, CR CC-I, 2e éd., Bâle 2023, N 3 s. ad art. 7 ; Rey Heinz, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 730 und 731 ZGB, in : Berner Kommentar IV/2/1, 2e éd., Berne 1981, N 79 ad art. 730 ; Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, Le droit des obligations, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, N 46 et 59. ↩
- Et donc respecter le droit public qui fait partie de l’ensemble de l’ordre juridique : ATF 139 III 404, consid. 7.4.2 = JdT 2014 II 407. ↩
- Hrubesch-Millauer Stephanie et al., Sachenrecht, 6e éd., Berne 2023, N 1546 ; Steinauer Paul-Henri, Les droits réels, tome II, 5e éd., Berne 2020, N 3315. ↩
- Le Tribunal fédéral fait usage de la notion « Erlass » : TF 5A_637/2019 du 27.04.2022, consid. 2.4 et TF 5C.213/2002 du 07.02.2003, consid. 3.2 ; Sevhonkian Naïri/Wermelinger Amédéo, Contrevenir à l’intérêt public à la densification au moyen d’une servitude – la mauvaise foi paie-t-elle ?, in : Papaux van Delden Marie-Laure et al. (édit.), Le juge apprécie – Mélanges en l’honneur de Bénédict Foëx, Genève/Zurich 2023, p. 345 ss, p. 349 : « Il faut entendre par ‘Erlass’, à notre sens, le moment de l’adoption d’une loi au sens formel, soit celui de son acceptation lors du vote final de chacune des deux chambres, conformément à l’art. 81 al. 2 LParl, et une fois le délai référendaire échu. ». ↩
- ATF 107 II 331, consid. 5a = JdT 1982 I 118 : « Inkrafttreten ». ↩
- ATF 91 II 339, consid. 4a = JdT 1966 I 242. ↩
- Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, § 508. ↩
- Pour un développement : Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, notamment § 198 ss. ↩
- P. ex. : le canton de Vaud, art. 51 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, recueil systématique de la législation vaudoise 700.11 ; le canton de Neuchâtel, art. 32a de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991, recueil systématique de la législation neuchâteloise 701 ; pour un développement : Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, § 366 ss. ↩
- Pour un développement : Sevhonkian Naïri, Le régime juridique des servitudes mis à l’épreuve par l’art. 15a LAT, thèse, Neuchâtel 2024, notamment § 421 ss. ↩
- Steinauer Paul-Henri, Les droits réels, tome II, 5e éd., Berne 2020, N 3379 ss. ↩
- TF 5A_395/2024 du 08.11.2024. ↩
- TF 5A_162/2021 du 09.09.2021. ↩
- Pour le tout : TF 5A_162/2021 du 09.09.2021, consid. 5. ↩
- Pour le tout : TF 5A_395/2024 du 08.11.2024, consid. 5.5. ↩
- Pradervand-Kernen Maryse/Schroeter Margaux, Le pouvoir d’appréciation du juge en relation avec la libération judiciaire des servitudes, in : Papaux van Delden Marie-Laure et al. (édit.), Le juge apprécie – Mélanges en l’honneur de Bénédict Foëx, Genève/Zurich, 2023, p. 213 ss, p. 234 : le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. ↩
- Dans de nombreuses causes, le Tribunal fédéral a refusé la libération de la servitude de restriction du droit à bâtir en vertu de l’art. 736 al. 2 CC, malgré l’augmentation de la charge due au développement du droit public de l’aménagement du territoire, tel qu’un changement d’affectation et l’admissibilité d’une densité des constructions plus importante : p. ex. TF 5A_128/2020 du 13.04.2021 ; TF 5A_340/2013 du 27.08.2013 ; TF 5C.155/1998 = SJ 1999 I 102 ; ATF 107 II 331 = JdT 1982 I 118. ↩